Microbiotalk: "World Microbiome Day"
Comprendre le microbiote à travers la science, la société et la participation
Cette édition spéciale de Microbiotalk, organisée pour la Journée mondiale du microbiome, met en lumière de nouvelles perspectives issues de l'Observatoire International des Microbiotes 2025, présente le projet de science citoyenne « Le French Gut », et donne la parole aux patients et conversations publiques qui façonnent notre compréhension collective du microbiote.
- Comprendre les microbiotes
- Microbiote et troubles associés
- Agir sur nos microbiotes
-
Publications
- À propos de l’Institut
Section professionnels de santé
Retrouvez ici votre espace dédié
en_sources_title
en_sources_text_start en_sources_text_end
Chapitres

A propos de cet article
Auteur
Alors que la science du microbiote continue de progresser, sa perception et son rôle dans la société sont encore en pleine évolution. Ce Microbiotalk, organisé par le Biocodex Microbiota Institute à l'occasion de la Journée mondiale du microbiome, rassemble des données scientifiques, l'engagement citoyen et les témoignages de patients afin d'explorer comment le microbiote façonne et est façonné par notre vie quotidienne.
Avec la participation d'experts tels que :
Etienne Mercier (Ipsos) – « Le microbiote sous la loupe : tendances en France et à l'étranger », Prof. Joël Doré (INRAE) – « Cartographie du microbiote de la population française : premiers résultats de Le French Gut », Patricia Renoul (APSII) – « Microbiote et maladies chroniques : un message d'espoir pour les patients », Dr. Julien Scanzi (CHU Clermont-Ferrand) – « Le microbiote sur les réseaux sociaux : médecins connectés, santé responsabilisée ».
En jetant un pont entre la science, la société et l'engagement citoyen, cet événement apporte un éclairage nouveau sur la manière dont la recherche sur le microbiote passe du laboratoire à la vie quotidienne et sur le rôle que chacun peut jouer pour faire avancer ce domaine.

Etienne Mercier
Le microbiote sous la loupe : Décryptage des tendances en France et à l'étranger

« Avant tout, vous découvrirez comment, selon la culture et le pays où l'on vit, on entretient une relation avec le microbiote, des connaissances et des comportements extrêmement différents. »
30 ans d'expérience dans les sondages d'opinion et les enquêtes sur la santé chez Ipsos Public Affairs - France
Expert en matière d'opinion et de santé, ce double rôle lui confère une vision globale des enjeux sociétaux (environnement, égalité des sexes, évaluation des politiques publiques) et sanitaires, lui permettant d'ancrer les données obtenues au cœur d'une réalité complexe.
Il dirige l'Observatoire International des Microbiotes depuis sa création.
Je n’ai pas beaucoup de temps pour présenter une enquête dont je pourrais parler pendant des heures, je vais donc devoir en résumer les points principaux.
Je vais tout d’abord vous présenter ce dispositif, qui existe depuis maintenant trois ans et qui est passionnant, car il est déployé à l’échelle mondiale.
Nous avons interrogé des personnes en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, au Mexique ; en Europe du Nord avec la Finlande ; en Europe de l’Est avec la Pologne ; et en Asie, en Chine et au Vietnam. Ce panorama de pays et de populations interrogées nous permet de disposer d’une grande richesse de données collectées. Il montre surtout que la connaissance du microbiote, l’intérêt pour les comportements qui y sont liés et la volonté de modifier ses habitudes pour améliorer sa santé varient selon les pays.
Chaque année, de nouveaux pays rejoignent le dispositif : c’est un outil qui évolue continuellement. L’an dernier, nous avons intégré la Pologne, la Finlande et le Vietnam ; cette année, l’Allemagne et l’Italie s’ajoutent à la liste. L’inclusion de l’Allemagne est particulièrement intéressante, car ce pays est plutôt moins performant en matière de connaissance du microbiote, mais nous y reviendrons.
Comme souvent avec Le French Gut, nous avons changé d’approche. Habituellement, nous présentons une vue d’ensemble mondiale ; cette année, nous avons choisi de comparer la France au reste du monde. Nous allons donc observer comment nous nous situons et comment nous nous comparons aux autres sur ce sujet.
Le premier thème porte naturellement sur la connaissance du microbiote et des termes associés. Où en sont les Français ? Ils ne s’en sortent pas mal : aujourd’hui, 88 % d’entre eux ont déjà entendu le mot « microbiote », contre 71 % dans le reste du monde, ce qui est bien meilleur. Nous restons toutefois un peu derrière les pays asiatiques, qui ont une culture plus forte de compréhension et de comportements favorables au maintien d’un microbiote intestinal sain. Les Vietnamiens, par exemple, affichent un taux de notoriété de 94 %.
Dans le détail, c’est encourageant, mais nous pouvons encore progresser, car seulement un tiers des Français savent précisément ce qu’est le microbiote. La bonne nouvelle, c’est que cette connaissance évolue positivement : en 2023, elle atteignait 81 %, en 2024, 85 %, et cette année, 88 %. La proportion de personnes bien informées augmente elle aussi.
C’est donc un motif de satisfaction. Que sait-on du microbiote ? Pour nous, il s’agit avant tout du microbiote intestinal, que nous connaissons mieux que d’autres, et du microbiote vaginal. Sur ces deux aspects, la France est en avance. En revanche, pour le microbiote cutané, nous sommes comparables aux autres pays ; et sur les microbiotes pulmonaire, ORL et urinaire, notre connaissance est plus faible. Cela peut sembler anecdotique, mais dans certains pays d’Asie ou au Brésil, ces microbiotes sont mieux connus, et il existe sans doute une corrélation avec de meilleurs comportements liés au microbiote.
Sur la connaissance en général, nous sommes légèrement en retard sur le reste du monde, mais la progression est constante, ce qui est positif. Pour mesurer cette connaissance, nous avons soumis un quiz aux Français, avec des affirmations auxquelles ils devaient répondre « vrai », « faux » ou « je ne sais pas ». Il apparaît que de nombreux Français connaissent bien certains principes : par exemple, 80 % savent que l’alimentation influence l’équilibre du microbiote, et 78 % qu’un déséquilibre du microbiote peut avoir des conséquences sur la santé.
Nous constatons donc des progrès. Ces connaissances n’ont pas beaucoup évolué cette année, mais elles continuent à progresser globalement. Dès que les gens comprennent le rôle et l’importance du microbiote, cela crée les conditions pour davantage de prévention et de passage à l’action. Le seul bémol est que, sur certains points, nous restons en retrait du reste du monde, notamment sur les aspects plus concrets de la compréhension et de l’intérêt pour le sujet.
Les Français savent que leur microbiote se situe dans l’intestin ; en revanche, beaucoup ignorent que certaines maladies, comme le syndrome de l’intestin irritable, peuvent être liées à un déséquilibre du microbiote. Le rôle du microbiote dans la communication entre l’intestin et le cerveau est également moins connu. Résultat : la France obtient un score moyen de 5,6 sur 9, contre 5,9 pour le reste du monde.
Nous avons donc une bonne connaissance des notions liées au microbiote et de son importance, mais cette connaissance ne se traduit pas suffisamment dans les comportements. C’est un véritable enjeu. En effet, lorsqu’on demande aux Français s’ils ont changé leurs habitudes pour protéger ou mieux équilibrer leur microbiote, seuls 45 % répondent oui, contre 56 % ailleurs.
Il y a donc un écart entre la connaissance et l’action. Ce constat est encore plus marqué chez les personnes âgées : seules 44 % d’entre elles déclarent avoir modifié leurs comportements pour améliorer l’équilibre de leur microbiote intestinal, alors même qu’elles sont les plus exposées aux maladies chroniques.
À la question « Qu’avez-vous fait pour mieux équilibrer votre microbiote ? », plusieurs réponses montrent des progrès : 84 % des Français disent avoir une alimentation variée et équilibrée, un résultat comparable au reste du monde. Ne pas fumer les place même au-dessus de la moyenne. En revanche, sur la pratique d’une activité physique ou la consommation de probiotiques et de prébiotiques, ils sont un peu en retrait.
Leur score global est de 4,3 sur 7, ce qui reste inférieur à celui des autres pays. Le vrai problème est le niveau d’information dont disposent les Français pour passer à l’action et mieux prendre soin de leur microbiote.
Ce manque d’information provient en grande partie des professionnels de santé. C’est dommage, car 96 % des Français leur font confiance pour les informer sur le microbiote — un taux supérieur à celui observé ailleurs et en hausse par rapport à l’année précédente. Les professionnels de santé ont donc un rôle essentiel à jouer.
Pourtant, ils ne répondent pas entièrement à cette attente : 37 % seulement des Français déclarent qu’un professionnel de santé les a sensibilisés à l’importance de préserver l’équilibre de leur microbiote, contre 46 % dans le reste du monde. Seuls 35 % disent avoir reçu des conseils pour maintenir un bon équilibre intestinal, contre 38 % à l’international.
Ce décalage est regrettable, car les Français sont prêts à agir, mais ne reçoivent pas les informations nécessaires. On le voit notamment avec les antibiotiques : 67 % savent qu’ils ont un effet négatif sur le microbiote, mais, lors d’une prescription, seuls 45 % disent avoir été avertis de troubles digestifs possibles, 31 % ont reçu des conseils pour en limiter les effets, et 29 % seulement ont été informés de leurs conséquences sur l’équilibre du microbiote.
Il est donc urgent que les professionnels de santé accompagnent mieux les Français pour les aider à progresser sur ce sujet.
Enfin, concernant les tests du microbiote, seuls 18 % des Français en ont entendu parler, contre 27 % ailleurs. Il reste donc beaucoup de communication à faire. Pourtant, 47 % se disent intéressés à l’idée de tester leur microbiote, même si, dans les faits, on sait que ce chiffre resterait bien moindre.
Cette ouverture montre toutefois un réel intérêt pour mieux comprendre le microbiote. Les Français souhaitent avant tout tester les microbiotes qu’ils connaissent le mieux, c’est-à-dire l’intestinal et le vaginal. Leur motivation principale est d’obtenir un bilan de santé complet : 64 % citent la prévention et le ralentissement de l’apparition des pathologies. Viennent ensuite, pour 28 %, la volonté de soutenir la recherche et le développement de nouvelles thérapies fondées sur le microbiote.
Ce dernier chiffre illustre bien le potentiel du projet Le French Gut : 28 % des Français seraient prêts à participer à des analyses pour faire progresser la recherche. Et, lorsqu’on évoque le don de selles, 46 % se disent disposés à le faire, même si cela reste en dessous du reste du monde, où la moyenne atteint 59 %. Comme pour le dépistage du cancer colorectal, il existe encore une gêne culturelle : en France, tout ce qui touche à ce sujet reste plus difficile à aborder.
Ces résultats montrent donc à la fois des avancées et des freins. Je vous invite à consulter l’ensemble des données, qui sont très éclairantes. Elles permettent de comprendre comment, selon la culture et le pays, la relation au microbiote, les connaissances et les comportements peuvent différer profondément.
Merci beaucoup.
3 messages clés
- Une forte sensibilisation, mais peu d'actions concrètes en France : 88 % des Français ont déjà entendu parler du terme « microbiote », un chiffre supérieur à la moyenne internationale (71 %). Cependant, seuls 45 % d'entre eux ont pris des mesures concrètes pour améliorer ou protéger leur microbiote, contre 56 % à l'échelle mondiale. Il existe un écart manifeste entre les connaissances et les comportements, en particulier chez les personnes âgées en France.
- Les professionnels de santé sont considérés comme fiables... mais sous-utilisés : 96 % des Français interrogés font confiance aux professionnels de santé pour les informer sur le microbiote, un taux plus élevé que dans les autres pays. Pourtant, seuls 37 % se souviennent qu'un professionnel de santé les a sensibilisés à l'équilibre du microbiote, et seulement 31 % ont reçu des conseils pour minimiser l'impact des antibiotiques sur leur microbiote. Cela montre une occasion manquée en matière de prévention et d'éducation.
- Fort potentiel d'engagement citoyen dans la science : bien que seulement 18 % des Français connaissent l'existence des tests de microbiote, 47 % se disent intéressés par ces tests. 28 % seraient prêts à participer à des tests de microbiote pour soutenir la recherche scientifique, ce qui souligne une attitude positive envers des initiatives telles que Le French Gut. La motivation principale reste le suivi de la santé personnelle, mais un intérêt collectif commence à émerger.
Résultats 2025 : L'Observatoire International des Microbiotes

Prof. Joël Doré, Phd
Cartographie du microbiote de la population française : premiers résultats de « le French Gut »
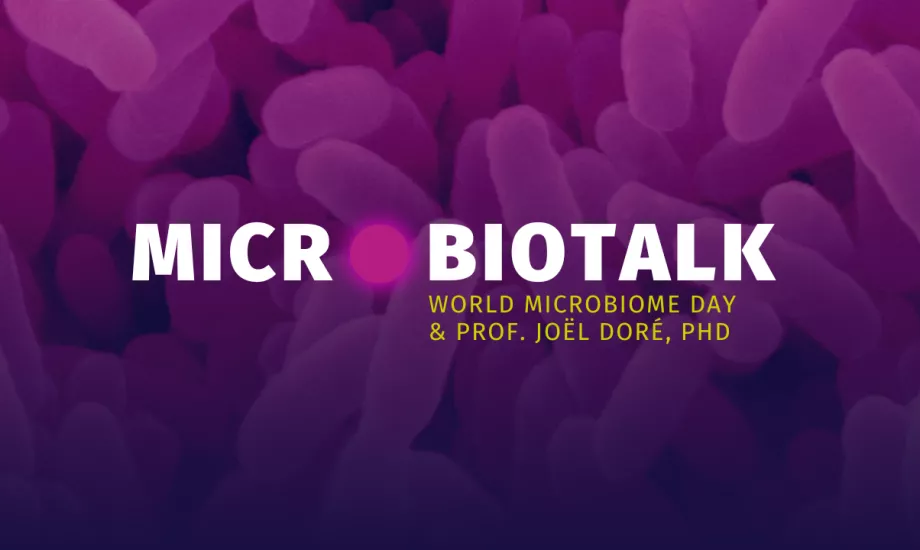
« Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on assiste à une épidémie de maladies chroniques dont l'augmentation est incontrôlée depuis 70 ans, des maladies qui touchent le système cardiovasculaire, le métabolisme cardiaque, l'obésité, le diabète, mais aussi les maladies inflammatoires, articulaires ou intestinales... »
Joël Doré est un microbiologiste français de renommée internationale, reconnu pour ses travaux pionniers sur le microbiote intestinal humain. Il est directeur de recherche à l'INRAE et directeur scientifique de MetaGenoPolis.
Depuis plus de 40 ans, il consacre ses recherches aux interactions entre les micro-organismes intestinaux et leurs hôtes humains. Il est l'un des premiers chercheurs à avoir mis en évidence l'importance du microbiote dans la prévention et le développement des maladies chroniques (MICI, obésité, diabète).
Il œuvre également à la diffusion de la science auprès du grand public et des professionnels de santé, notamment à travers le projet Le French Gut, qu'il co-dirige.
Auteur et conférencier prolifique, il prône une approche holistique et préventive de la santé, dans laquelle l'alimentation et la qualité du microbiote sont des facteurs clés.
Je vais commencer par vous parler de la situation que nous connaissons actuellement. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous sommes confrontés à une épidémie de maladies chroniques dont l'augmentation est incontrôlée depuis 70 ans, des maladies qui touchent le système cardiovasculaire, le cardiométabolisme, l'obésité, le diabète, mais aussi les maladies inflammatoires, articulaires ou intestinales, les maladies du foie, puis les maladies qui touchent le système nerveux, neurodégénératives ou neuropsychiatriques, par exemple.
Cela représente 41 millions de décès en 2019.
74 % des décès sont liés à une maladie chronique. Cela signifie qu'en 2025, une personne sur quatre sera touchée par au moins l'une de ces maladies et, souvent, nous avons plusieurs problèmes de santé, des maladies chroniques cumulées. Selon les prévisions de l'Organisation, une personne sur deux dans le monde sera obèse d'ici 2035.
Nous pouvons donc constater que les choses évoluent vraiment d'une certaine manière. C'est assez impressionnant, mais pas dans le bon sens.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que nous n'avons pas compris à quoi nous avons affaire. Nous avons affaire à un être humain microbien, nous avons affaire à une symbiose, et cela n'est pas encore pris en compte dans nos comportements qui ont été mentionnés, mais aussi dans la pratique médicale actuelle. Nous avons pu caractériser le microbiote, nous avons pu tester le microbiote dans un sens quelque peu générique du terme et caractériser les variations ou les variabilités du microbiote dans différents contextes.
À gauche, ici, nous avons cette image d'une différenciation des microbiomes des personnes vivant dans un environnement industrialisé ou non industrialisé. Et puis, au milieu, ce que nous représentons ici, c'est cette histoire qui nous dit que le microbiote est important, que le microbiote joue un rôle dans un grand nombre de pathologies pour lesquelles une altération du microbiote a été documentée par rapport à des individus qui sont restés en bonne santé. Et ces maladies sont assez nombreuses, elles concernent en fin de compte les pathologies majeures de la société moderne, dont l'incidence est en augmentation, comme nous l'avons vu. Mais cela concerne également des paramètres humains, notamment la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydatif, qui font vieillir nos cellules un peu plus vite que nous le souhaiterions, en fait, et qui peuvent également altérer davantage le microbiote intestinal.
On voit bien comment cette situation peut devenir un peu un cercle vicieux qui s'installe sous la forme d'un cercle vicieux. Et c'est ce que l'on documente aujourd'hui dans les maladies chroniques. Peut-être est-ce lié à cette idée que nous n'avons pas tout à fait compris ce que nous devons faire lorsque nous nous adressons au microbien humain. Donc, quand on zoome un peu sur la perception actuelle de cela qui concerne le test du microbiote intestinal.
Il y a une sorte de colère grandissante. Une petite colère, qui se traduit par des articles d'opinion dans les journaux ou dans la littérature scientifique. Ce sont des commentaires de collègues nord-américains, qui nous parlent ici du DTC, le Direct to Consumer, la caractérisation du microbiote à la demande de M. Tout-le-monde, qui devrait vraiment être un peu mieux réglementée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cela pourrait donc être un sujet de discussion. Mais nous partons de là.
Aujourd'hui, il existe de nombreuses petites entreprises qui proposent des analyses du microbiote, parfois pour quelques centaines d'euros, et qui fournissent un rapport de quarante pages avec de belles images qui vous montrent à quoi vous ressemblez lorsque vous prenez un selfie de l'intérieur. Cela pose problème, car ces personnes consulteront leur médecin avec une bonne relation que la médecine ne peut pas gérer aujourd'hui. Et nous aimerions en effet parvenir à ce cercle vertueux qui permettrait aux médecins de prescrire l'analyse du microbiote en même temps que les analyses biologiques classiques, comme les analyses de sang ou d'urine, par le biais des laboratoires de biologie médicale, qui sont l'interface naturelle dans ce schéma, dans ce circuit.
Dans quel but ?
Enfin, intégrer ces données sur le microbiote dans la pratique médicale. Il s'agit de diagnostiquer les altérations du microbiote et de la symbiose. Il s'agit de suivre l'évolution de la symbiose tout au long du parcours du patient, en particulier pendant le traitement. Et puis, il s'agit d'intégrer les données sur le microbiote et la symbiose dans les recommandations nutritionnelles, par exemple, ou dans les soins médicaux. Pour que ce cercle vertueux s'établisse,
de quoi avons-nous besoin ?
Il faut des normes. Je vais vous expliquer que nous les avons déjà. Il faut des grands nombres et, bien sûr, Le French gut joue un rôle dans ce schéma en apportant des grands nombres pour construire la référence. Et ensuite, il faudra le démontrer avec des preuves, avec des preuves scientifiques qu'il y a un bénéfice clinique, un bénéfice à l'apport. Si bien sûr le médecin est formé au microbiote intestinal. L'éducation et la formation des patients seront également nécessaires pour les professionnels de santé. En réalité, nous constatons assez souvent aujourd'hui que l'éducation des patients se fait presque entièrement en ligne, un peu plus rapidement que l'adaptation de la formation des professionnels de santé aux connaissances scientifiques qui, elles-mêmes, évoluent très rapidement.
Comme je le disais, nous avons les normes. En ce qui nous concerne, nous avons publié en 2017 les normes qui permettent d'analyser le microbiote intestinal de manière totalement standardisée, à tel point que si cela était fait de la même manière aux États-Unis, en Europe et en Australie, nous obtiendrions le même résultat.
C'est ce qui est vraiment nécessaire pour une application clinique. Et puis, nous avons également vu apparaître des équipements de référence qui nous permettent de calibrer les processus que nous mettons en œuvre pour effectuer cette analyse. Et nous avons des collègues scientifiques aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, qui nous proposent des outils qui vont dans ce sens. Cet aspect est réglé.
Ce qui reste à fournir pour ce schéma, c'est le grand nombre et le microbiote français. Le French Gut vise à accélérer la recherche sur le microbiote et donc à fournir ces informations supplémentaires. Il s'agit d'un projet d'intérêt public visant à améliorer la prévention pour dépister, diagnostiquer et traiter les maladies chroniques de demain. Et l'objectif que nous nous sommes fixé est, d'ici 2029, de collecter et de caractériser ceux de 100 000 volontaires en France, adultes, résidents français et également des personnes en bonne santé par rapport à des personnes malades.
Dans quel but ?
Définir la référence, les normes du microbiote, les plages de variation des paramètres classiques, habituels et dominants du microbiote intestinal chez l'individu sain et mieux comprendre son altération dans la maladie. Il s'agit également de jeter les bases d'un véritable développement de recommandations nutritionnelles, éventuellement préventives et personnalisées, afin d'ouvrir la voie à de nouvelles thérapies, notamment dans le contexte des maladies chroniques, mais aussi de sensibiliser le grand public, les adultes et les enfants qui sont ou seront demain les gardiens de leur santé. Il s'agit d'un projet mené par l'INRAE, qui est réalisé en très étroite collaboration avec l'Assistance publique et les hôpitaux parisiens, au PHP, et qui rassemble des partenaires publics et privés, des institutions publiques telles que Agro ParisTech, l'Inserm, le CEA, l'Institut Pasteur et l'INRIA, ainsi que des entreprises privées telles que Biocodex, depuis le début, comme cela a été mentionné, pour le secteur pharmaceutique, mais aussi des partenaires qui couvrent davantage l'aspect nutritionnel ou les ingrédients et GMT pour l'analyse du microbiote intestinal à des fins médicales.
Il s'agit d'un projet soutenu par de nombreux partenaires en matière de communication. Je voudrais dire que vous pouvez tous être comme ça, mais nous avons des ambassadeurs, notamment Michel Cymes, Marine Lorphelin, Jimmy Mohamed et Julien Scanzi, qui prendront la parole après moi et qui communiquent avec des millions de personnes via Internet, en particulier.
Comment procédons-nous ?
Nous travaillons depuis des années, je dirais, à simplifier autant que possible le parcours des bénévoles. Ainsi, en tant que bénévole, vous devrez vous inscrire sur Internet et créer une page personnelle. Ensuite, vous devrez bien sûr vérifier que vous remplissez les conditions requises. L'éligibilité repose sur plusieurs critères. Il faut être âgé de plus de 18 ans, ne pas être sous tutelle ou curatelle, résider en France métropolitaine et ne pas avoir pris d'antibiotiques ni subi de coloscopie au cours des trois mois précédant le don. Enfin, si vous recevez votre kit de prélèvement et que vous devez prendre un antibiotique pour une raison quelconque.
Si vous ne vous sentez pas bien, revenez nous voir dans trois mois et tout ira bien. Il n'y a aucun problème. Le processus est le suivant : je m'inscris, je signe un formulaire de consentement. Il s'agit d'un exemple classique d'éthique dans les études de cohorte. Un consentement éclairé qui vous informera que vous participez à l'étude. Et puis aussi un deuxième consentement qui nous dira si vous acceptez d'être recontacté à l'avenir pour explorer la relation entre l'alimentation, la santé et les microbiomes à travers des questionnaires supplémentaires, par exemple, ou bien si vous proposez de participer à des études spécifiques sur des questions complexes dans la science des microbiomes. Vous remplissez quelques questionnaires, le questionnaire de base obligatoire est rempli en environ une cinquantaine de questions, donc cela prend 15 à 20 minutes.
Cependant, vous disposez également de questionnaires facultatifs que vous pouvez remplir dans ce formulaire, qui nous en apprendront davantage sur vous, vos habitudes alimentaires, votre mode de vie ou votre état de santé. Le kit présenté ici dans le coin supérieur droit est un kit similaire à celui utilisé pour le dépistage du cancer colorectal. En fait, nous l'avons simplifié autant que possible. Vous placez une selle sur un petit hamac en papier dans les toilettes et vous disposez d'un coton-tige ou d'un équivalent à placer dans la selle, puis vous placez ce morceau de coton dans un tube qui stabilise complètement votre échantillon pendant une semaine et qui est envoyé par la poste. L'impact est vraiment minimisé.
Néanmoins, certaines personnes ont du mal à faire ce geste. Nous le comprenons. Devenez l'un de nos bénévoles, rejoignez notre équipe de communication. J'en parlerai plus tard.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Nous avons un peu plus de 25 000 participants qui sont effectivement venus vers nous en tant que bénévoles. Cela représente un quart de notre objectif. Nous allons donc continuer à travailler, à communiquer et à recruter de nouveaux bénévoles. En termes d'âge, il s'agit principalement de personnes d'âge moyen, entre 40 et 60 ans. C'est là que nous avons le plus de monde.
Nous avons un peu moins de personnes âgées ou très âgées que nous le souhaiterions. Un peu moins de jeunes adultes que nous le souhaiterions. 70 % sont des femmes. Messieurs, à vos tablettes ou à vos toilettes. Et puis, la répartition nationale correspond de manière impressionnante à la démographie de la population française. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur des bénévoles dans tout le pays. Un peu moins dans le Nord, un peu moins en Corse. Évidemment, je tiens à le dire, mais malgré tout, nous avons une très bonne représentation.
Et puis, un tiers de nos bénévoles sont... des patients qui consultent pour une pathologie, principalement des maladies respiratoires ou cardiométaboliques. En fait, l'hypertension, par exemple, vient après les maladies digestives. Évidemment, il y a ensuite les maladies systémiques ou auto-immunes. Et puis, enfin, les maladies neurologiques. Le système nerveux est impliqué.
Je ne vois pas les chiffres car c'est un peu loin pour moi, mais nous avons un peu plus de 80 % de personnes qui n'ont jamais fumé parmi nos volontaires. Environ 80 % des personnes sont omnivores. Bien sûr, nous nous intéressons également aux habitudes alimentaires. Et puis, nous avons une forte proportion de personnes qui déclarent avoir une activité physique régulière, à savoir au moins 30 minutes par jour de marche dynamique.
Voilà, vous pouvez tous communiquer. Idéalement, vous devriez contacter frenchgut-press@inrae.fr pour obtenir les outils de communication qui vous sont confiés, par exemple une affiche à imprimer et à apposer dans votre pharmacie ou votre supermarché. Et puis, éventuellement, des kits, des dépliants à distribuer autour de vous. Impliquez également les membres de votre famille. C'est important pour nous.
3 messages clés
- Les maladies chroniques sont en augmentation — et le microbiote est la pièce manquante du puzzle : Le monde est confronté à une épidémie mondiale de maladies chroniques, responsables de 74 % des décès en 2019. Malgré les progrès réalisés dans le domaine des soins de santé, nous n'avons pas encore pleinement intégré le microbiote dans la réflexion médicale ou le comportement du public. Le microbiote intestinal joue un rôle avéré dans de nombreuses maladies chroniques (par exemple, cardiométaboliques, inflammatoires, neurodégénératives), mais cette dimension « microbienne humaine » est encore négligée dans la pratique médicale.
-
Des tests grand public à l'intégration clinique : un changement de paradigme s'impose : l'essor des tests microbiotiques grand public (DTC) sème la confusion ; les patients se présentent avec des résultats que les professionnels de santé ne sont pas prêts à interpréter. L'objectif est de construire un modèle médical vertueux où les données microbiotiques sont analysées dans des conditions standardisées et cliniquement valides, intégrées aux tests de laboratoire de routine.
-
Le French Gut : construire une référence nationale pour la prévention et l'innovation : le projet French Gut, mené par l'INRAE avec des partenaires publics et privés (dont Biocodex), vise à collecter les données sur le microbiote de 100 000 volontaires d'ici 2029. Avec plus de 25 000 participants déjà inclus, le projet contribuera à définir des plages de référence pour le microbiote, à étayer les recommandations nutritionnelles et à permettre de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Patricia Renoul
Microbiote et maladies chroniques : un message d'espoir pour les patients

« Avant tout, il s'agit d'aider et de soutenir ceux qui souffrent afin de leur permettre de sortir de leur isolement. »
Patricia Renoul est présidente de l'APSSII (Association des patients souffrant du syndrome du côlon irritable) depuis 2022, après avoir été bénévole depuis 2019 puis membre du conseil d'administration.
L'APSSII a été créée en 2010 par deux professeurs de gastro-entérologie, le professeur Sabaté (AP-HP) et le professeur Piche (CHU Nice). L'APSSII est une association à but non lucratif agréée par le ministère de la Santé.
L’Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable (APSII) est une organisation nationale à but non lucratif, régie par la loi de 1901, et présente sur l’ensemble du territoire, dans toutes les régions françaises. Depuis la fin de l’année 2024, nous avons obtenu un agrément du ministère de la Santé, qui nous permet de représenter l’ensemble des patients dans les établissements hospitaliers, qu’ils soient publics, privés ou relevant d’institutions nationales.
Pour notre association, il s’agit d’une véritable avancée et d’une reconnaissance importante. Cela implique aussi des responsabilités, puisque certains de nos membres, afin de maintenir cet agrément, doivent participer à la représentation des usagers au sein de ces instances. C’est donc une étape majeure pour notre association, qui, comme Élodie l’a rappelé, fête aujourd’hui ses 15 ans.
L’association est née d’un constat formulé par les professeurs Sabaté et Piché : le syndrome de l’intestin irritable souffrait d’un manque de reconnaissance, aussi bien de la part du grand public que des professionnels de santé. C’est dans ce contexte qu’a été créée l’APSII en 2010.
Ses missions sont celles d’une association de patients, en cohérence avec les valeurs qu’elle défend. La première mission est d’aider et de soutenir les personnes qui souffrent, afin de leur permettre de sortir de l’isolement. Comme certains d’entre vous le savent, cette maladie n’est pas mortelle, mais elle altère profondément la qualité de vie, parfois pendant des années.
La deuxième mission de l’association est de soutenir et de promouvoir la recherche. À ce titre, nous sommes aujourd’hui très impliqués dans le projet Le French Gut, qui constitue pour nous un premier partenariat significatif, notamment sur le plan financier.
La troisième mission est d’informer, de sensibiliser et de le faire de manière fiable. Enfin, la quatrième mission est de défendre les droits des personnes atteintes. Cela inclut l’accompagnement des enfants et adolescents, le soutien aux aidants, ainsi qu’un appui aux patients souhaitant obtenir une reconnaissance en tant que travailleurs handicapés.
Revenons à un point fondamental : la définition du syndrome de l’intestin irritable (SII). Le diagnostic repose sur les critères de Rome, établis en 2016 par un groupe d’experts internationaux. Le SII se définit comme des douleurs abdominales récurrentes, survenant au moins un jour par semaine au cours des trois derniers mois, associées à au moins deux des critères suivants : lien entre la douleur et la défécation (avant ou après), modification de la fréquence des selles, et changement de leur aspect. En résumé, le syndrome de l’intestin irritable se manifeste par des douleurs abdominales et des troubles du transit, auxquels s’ajoutent souvent des symptômes secondaires comme les ballonnements, les gaz, les douleurs anales ou lombaires.
Les témoignages recueillis auprès de nos membres montrent d’ailleurs une grande diversité de symptômes et d’effets associés à la maladie. On parle aujourd’hui d’une définition évolutive : on ne dit plus « syndrome du côlon irritable » mais bien « syndrome de l’intestin irritable », car il concerne à la fois le petit et le gros intestin. On évoque désormais les interactions intestin-cerveau, qui traduisent la communication bidirectionnelle entre ces deux organes.
En France, entre 5 et 10 % de la population est concernée par le SII, à des degrés divers. Parmi nos membres, certains présentent des formes modérées, d’autres doivent interrompre leur activité professionnelle. Les deux tiers des personnes atteintes sont des femmes, plus nombreuses à consulter et à déclarer leur maladie. Le SII représente aujourd’hui la première cause de consultation en gastro-entérologie.
Sur le plan alimentaire, 73 % des patients estiment que leur régime déclenche leurs symptômes. Le SII est une affection chronique, et à ce titre, il entraîne des difficultés durables dans la vie quotidienne. Ce n’est pas une maladie mortelle, mais elle peut être extrêmement invalidante : certaines personnes ont jusqu’à dix à quinze selles par jour, ce qui rend très difficile une vie professionnelle, sociale ou familiale normale.
Malgré cela, la pathologie reste méconnue et banalisée. Combien de patients entendent encore « c’est dans votre tête », ou « tout le monde a mal au ventre » ? Le SII est pourtant une maladie aux causes multiples. Plusieurs facteurs ont été identifiés : hypersensibilité viscérale, altération de la communication entre l’intestin et le cerveau, infections intestinales, troubles de la motricité intestinale… Et, désormais, le déséquilibre du microbiote est reconnu comme un facteur majeur. C’est sur cette dimension que le projet Le French Gut travaille activement, en collaboration avec nous.
Le diagnostic du SII reste complexe, et les réponses thérapeutiques le sont tout autant. Parce que les causes sont multiples, les traitements sont eux aussi variés et pluridisciplinaires : médicaments, approches non médicamenteuses, activité physique, adaptations alimentaires… Mais ce qui ressort des témoignages, c’est que les patients essaient beaucoup de choses : certaines fonctionnent, d’autres non, ou cessent d’être efficaces après un certain temps. Les médecins eux-mêmes soulignent que les patients atteints de SII sont des cas complexes à traiter.
Le SII est une source de souffrance physique, mais aussi psychologique. Vivre avec des douleurs quotidiennes, parfois pendant des années, est difficile. Certains de nos membres ont été diagnostiqués à 14 ans et en ont aujourd’hui 70. C’est, comme ils le disent, une vie de combat.
Cette souffrance prolongée affecte inévitablement la santé mentale, et la qualité de vie dans son ensemble : vie professionnelle, vie sociale, vie familiale et affective. Le SII est une maladie invisible, souvent incomprise, même par l’entourage proche. Il peut aussi générer un sentiment de culpabilité, lié à une vision psychosomatique erronée : « c’est dans la tête », « détendez-vous », « faites du yoga, du tai-chi, et ça ira mieux ».
Sur le plan alimentaire, 73 % des patients estiment que leur régime déclenche leurs symptômes, et 93 % pensent qu’il les aggrave. L’alimentation représente donc un enjeu majeur. Des régimes spécifiques, comme le régime pauvre en FODMAPs ou le régime méditerranéen, peuvent être proposés, mais ils sont souvent contraignants et nécessitent un accompagnement diététique. Ces restrictions peuvent à long terme entraîner des troubles du comportement alimentaire.
Dans ce contexte, la recherche sur le microbiote représente un immense espoir pour les patients. Elle ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques, liées à l’alimentation et à la correction de la dysbiose, ce déséquilibre du microbiote intestinal aujourd’hui reconnu comme une cause du SII.
C’est un champ de recherche majeur, porteur d’espoir. L’APSII est en train de finaliser un accord avec l’INRAE et l’AP-HP dans le cadre du projet Le French Gut. Ce partenariat prévoit un recueil ciblé d’échantillons de selles de patients atteints de SII, afin d’analyser leur microbiote et de développer des pistes thérapeutiques adaptées.
Pour nous, patients, c’est un véritable message d’espoir. Les traitements actuels sont multiples, parfois complexes, et les résultats restent inégaux. Identifier une cause précise et y associer une réponse thérapeutique efficace changerait profondément la vie des personnes concernées.
3 messages clés
- Le SCI est une maladie chronique, invisible et mal comprise, qui a des répercussions très réelles : il touche 5 à 10 % de la population française, principalement des femmes (2/3 des cas), et a un impact profond sur la vie quotidienne, notamment sur le bien-être social, professionnel et émotionnel. Bien qu'elle ne soit pas mortelle, cette affection est souvent banalisée et mal comprise, même par les professionnels de santé. De nombreux patients rapportent s'être entendu dire « tout est dans votre tête ». La maladie a des origines multifactorielles (hypersensibilité viscérale, dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau, déséquilibre du microbiote...) et entraîne des réponses thérapeutiques complexes et variables.
-
Le microbiote est une source d'espoir pour les patients : pour les patients, la recherche sur le microbiote intestinal représente un espoir thérapeutique majeur. La dysbiose (déséquilibre du microbiote) est désormais reconnue comme l'un des principaux facteurs contribuant au SII. L'association participe activement au projet French Gut, contribuant à la recherche scientifique et à la collecte de données afin de mieux comprendre les mécanismes du SII et de soutenir les traitements futurs. Un accord avec l'INRAE et l'AP-HP permettra de prélever des échantillons de selles ciblés auprès de patients atteints du SII afin d'alimenter les études sur le microbiote et d'identifier des voies thérapeutiques personnalisées.
- L'association de patients joue un rôle clé : soutien, représentation et défense des intérêts : depuis 2024, l'association est officiellement reconnue par le ministère de la Santé, ce qui lui confère la capacité de représenter les patients dans les établissements de santé. Ses missions comprennent : aider les patients à sortir de leur isolement, promouvoir la recherche, fournir des informations fiables, défendre les droits des patients, notamment l'accès à la reconnaissance du handicap, et soutenir les aidants. Elle sensibilise également à l'impact alimentaire du SII : 73 % des patients déclarent que l'alimentation déclenche des symptômes, 93 % estiment que leur régime alimentaire aggrave leur état, les régimes restrictifs sont difficiles à suivre et peuvent entraîner des troubles alimentaires, ce qui montre la nécessité d'un soutien personnalisé.

Dr. Julien Scanzi, M.D.
Microbiote sur les réseaux sociaux : médecins connectés, santé responsabilisée

« Nous pouvons donc tous dire ce que nous voulons sur les réseaux sociaux. Les médecins un peu moins, surtout depuis l'arrivée d'une charte en 2025 qui était attendue. »
Gastro-entérologue à l'hôpital Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand, auteur et conférencier, influenceur santé sur le thème du microbiote intestinal.
Je ne vais pas vous parler ici du microbiote, sujet que j’aborde très souvent, ni du syndrome de l’intestin irritable, que je traite également fréquemment, mais plutôt de mon activité de médecin et d’influenceur santé. Je vais vous expliquer comment tout a commencé, à travers une expérience particulière : une transplantation fécale. C’est d’ailleurs ce qui m’amène à être ici aujourd’hui.
Je suis gastro-entérologue en Auvergne, à l’hôpital Thiers du CHU de Clermont-Ferrand. J’exerce une activité de gastro-entérologie générale, mais je m’intéresse particulièrement au microbiote et à la transmission des connaissances, à mes confrères comme au grand public. Je vais donc vous expliquer comment, à partir de mon activité médicale, j’en suis venu à être suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs milliers de personnes.
Vous avez probablement déjà entendu parler de la transplantation fécale. Cette approche thérapeutique a connu un véritable tournant en 2013, avec la publication d’une importante étude néerlandaise démontrant l’efficacité de la transplantation de microbiote fécal – c’est-à-dire le traitement d’un patient à partir du microbiote d’une personne saine. Cette étude, publiée en deux volets, a montré l’efficacité de la procédure dans les infections récidivantes à Clostridioides difficile.
À la suite de cette publication, j’ai eu la chance de pouvoir proposer cette thérapie à une patiente gravement malade, hospitalisée pour la sixième fois à cause de cette infection. Son état de santé était très dégradé. Nous avons tenté cette procédure, encore peu pratiquée à l’époque en France, et elle s’est rétablie rapidement. Je me suis alors dit : « Ce que nous venons de faire est incroyable. Nous avons probablement sauvé une patiente en lui transférant le microbiote d’une autre personne. » La puissance du microbiote m’a profondément marqué.
Par la suite, j’ai continué à m’y intéresser et j’ai eu la chance de participer, au sein d’un comité d’experts de l’ANSM, à la rédaction d’un protocole encadrant cette procédure. Le groupe français de transplantation fécale s’est rapidement structuré, sous l’impulsion du professeur Harry Sokol, que vous connaissez sans doute. Des recommandations officielles ont été établies. Mais au-delà de cette pratique, c’est surtout l’impact global du microbiote sur la santé qui m’a passionné.
Cela a marqué un véritable tournant dans ma carrière. À cette époque, je pensais plutôt m’orienter vers l’endoscopie digestive. Mais la curiosité suscitée par le microbiote, à un moment où les découvertes scientifiques se multipliaient chaque jour, a totalement changé ma trajectoire. De nouvelles études montraient sans cesse le rôle du microbiote intestinal dans notre santé. En tant que médecin, j’avais accès à ces connaissances, mais je me suis vite rendu compte qu’elles concernaient tout le monde.
Nous sommes tous des êtres microbiens, et pour prendre soin de notre santé humaine, nous devons aussi prendre soin de notre santé microbienne. Cette idée m’a beaucoup marqué. Je me suis dit qu’il fallait partager ces connaissances au-delà du milieu médical. La période du Covid-19 a renforcé ce besoin de compréhension et de prévention. Beaucoup de personnes se sont alors intéressées davantage à leur santé, mais aussi à de nombreuses fausses informations circulant sur Internet.
En tant que professionnel de santé, je me suis davantage identifié à une médecine holistique, intégrative et humaine, dans laquelle le microbiote a toute sa place. Je me suis demandé comment sensibiliser le plus grand nombre. Autour de moi, beaucoup de chercheurs travaillent sur des thèses, publient des articles, mais cela reste réservé à un public restreint. J’ai préféré m’adresser au grand public, en écrivant un livre de vulgarisation scientifique sur le microbiote intestinal.
Trouver un éditeur n’a pas été simple, mais j’ai fini par y parvenir, et j’ai pu publier ce livre. Rapidement, je me suis rendu compte que publier un livre ne suffisait pas : encore fallait-il qu’il soit lu. N’ayant ni émission de radio ni présence médiatique, j’ai choisi de me tourner vers les réseaux sociaux pour le faire connaître. Au départ, c’était simplement un moyen de promotion, mais très vite, cela est devenu un véritable canal de communication. Même si la majorité de mes abonnés n’ont pas acheté le livre, ils ont pu accéder aux mêmes connaissances à travers mes publications : vidéos, carrousels, articles, etc.
Les réseaux sociaux m’ont permis de sensibiliser un public de plus en plus large et, surtout, de favoriser des changements de comportement. Comme l’a rappelé Joël Doré, nous sommes confrontés à une épidémie mondiale de maladies chroniques, en grande partie liées à notre environnement et à notre mode de vie. Ces deux éléments ont un impact majeur sur notre microbiote, et donc sur notre santé. Comprendre ces interactions est essentiel pour prévenir les maladies chroniques et améliorer le bien-être général.
J’ai commencé sur LinkedIn, puis sur Instagram, en publiant régulièrement deux à trois fois par semaine. C’est un travail conséquent, qui demande d’apprendre beaucoup de choses que la médecine ne nous enseigne pas : rédiger des publications accessibles à un public non médical, vulgariser sans déformer, comprendre les algorithmes des plateformes, utiliser des outils comme Canva pour les visuels, CapCut pour le montage vidéo, ou Magic pour les sous-titres. C’est un véritable second métier que j’ai appris au fil du temps.
Tout cela contribue à une transformation de notre rapport au microbiote, à la santé intestinale et à nos modes de vie. L’objectif est de promouvoir des changements positifs dans les comportements et de soutenir des initiatives comme Le French Gut. Grâce à ma présence en ligne, j’ai pu relayer ce projet de science participative et en parler au grand public.
Sur les réseaux sociaux, tout le monde peut s’exprimer librement. Les médecins, un peu moins, surtout depuis la mise en place, en 2025, d’une charte professionnelle attendue depuis longtemps. Elle encadre la prise de parole des soignants en ligne, afin d’éviter la désinformation, et c’est une bonne chose. Malheureusement, cette charte ne s’applique pas à d’autres acteurs qui peuvent, eux, diffuser tout et n’importe quoi. Les réseaux sociaux sont donc à la fois un outil formidable de diffusion des connaissances et une source de confusion lorsqu’on ne sait pas trier l’information.
Aujourd’hui, je mesure le chemin parcouru. Ma communauté s’est largement développée, me donnant une vraie légitimité pour continuer à parler de ces sujets. Cela montre l’intérêt croissant du public pour la santé, la prévention et le microbiote intestinal. Ces échanges me permettent aussi d’aborder des thématiques plus larges, comme le dépistage et la prévention de certains cancers, notamment à l’occasion d’événements comme Mars Bleu, ou encore de déconstruire des idées reçues et de sensibiliser le grand public.
Mais un autre enjeu majeur demeure : celui de la formation des professionnels de santé. Le public commence à s’approprier le sujet du microbiote et à modifier ses comportements, mais les soignants manquent encore de connaissances sur son rôle dans la santé globale. C’est à eux aussi de transmettre les bons conseils, de sensibiliser et d’accompagner les patients.
C’est pourquoi je travaille aujourd’hui sur d’autres projets : un site Internet et des formations dédiées. Il existe en effet un véritable manque de formation dans ce domaine. Pour vous donner un exemple, en dix années d’études de médecine, je n’ai jamais entendu le mot « microbiote », et le mot « probiotique » n’a été cité qu’une seule fois. Il y a donc un réel retard à combler, à une époque où nous avons pourtant accès à tant d’informations, via Internet, les réseaux sociaux ou l’intelligence artificielle.
3 messages clés
- De la pratique médicale à la communication numérique : un changement motivé par la conviction : le Dr Scanzi a commencé son parcours avec un cas transformateur de transplantation de microbiote fécal, qui a sauvé un patient gravement malade. Ce moment a suscité son intérêt profond pour le pouvoir du microbiote et a changé la trajectoire de sa carrière. Motivé par le manque d'enseignement sur le microbiote dans la formation médicale et par les preuves scientifiques de plus en plus nombreuses, il s'est donné pour mission de combler le fossé entre les connaissances médicales et le grand public. Son parcours l'a conduit à devenir un médecin-influenceur, utilisant les réseaux sociaux comme un outil pour informer, éduquer et susciter l'intérêt.
- Les réseaux sociaux comme outil de santé publique et de vulgarisation scientifique : initialement utilisés pour promouvoir son livre sur le microbiote, les réseaux sociaux sont rapidement devenus son principal canal d'éducation. Il insiste sur la responsabilité des médecins en ligne, en particulier dans le cadre de la nouvelle charte professionnelle de 2025, et la compare à l'espace non réglementé de la désinformation en matière de santé. À travers des vidéos, des carrousels et des publications, il vise à favoriser les changements de comportement, à sensibiliser à la prévention des maladies chroniques et à promouvoir une communication sur la santé fondée sur des preuves.
- Le besoin urgent de former les professionnels de santé sur le microbiote : malgré l'intérêt du public, la plupart des professionnels de santé sont mal informés sur le microbiote : « En 10 ans d'études de médecine, je n'ai jamais entendu le mot microbiote. » Le Dr Scanzi estime que les médecins doivent rattraper leur retard afin de fournir des conseils pertinents, soutenir les efforts de prévention et retrouver leur rôle éducatif. Il préconise des programmes de formation, des campagnes de sensibilisation et l'intégration du microbiote dans les soins et le dépistage de routine, y compris la participation à des projets scientifiques citoyens tels que Le French Gut, qu'il promeut via ses plateformes.
Comment décrypter les tendances en matière de santé intestinale sur les réseaux sociaux
BMI-25.52












