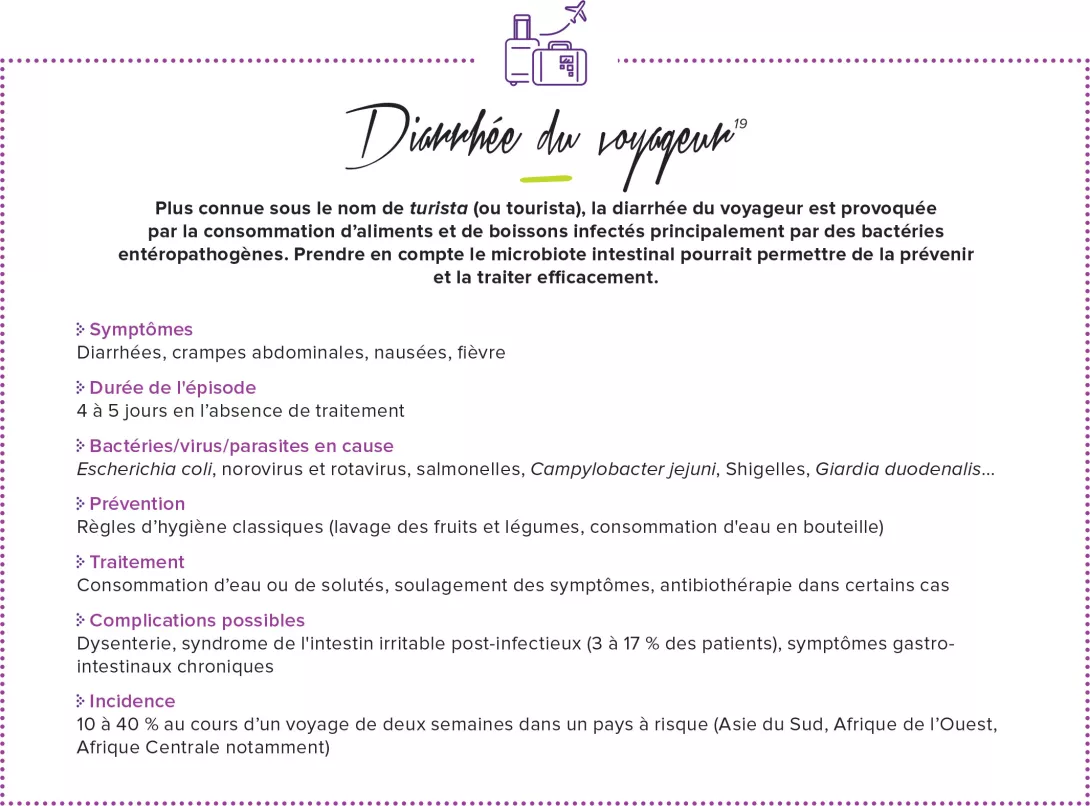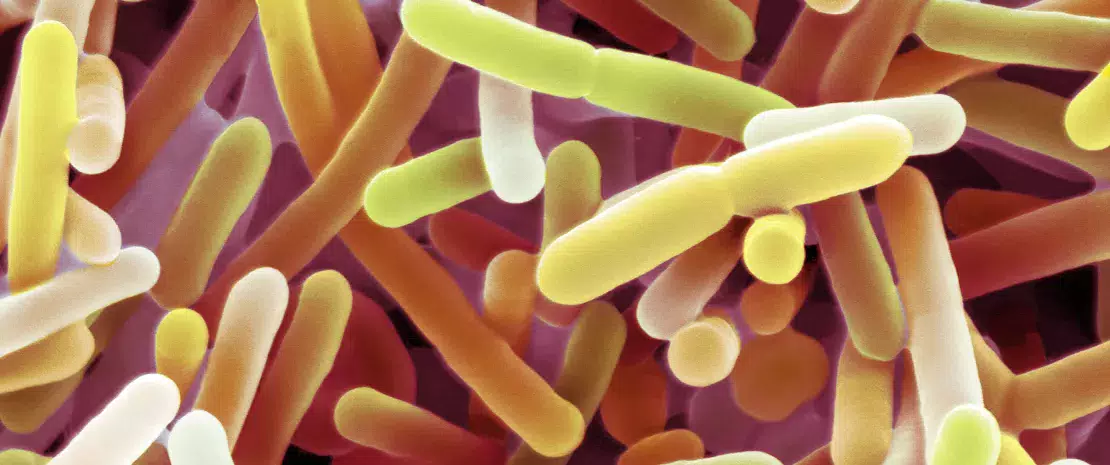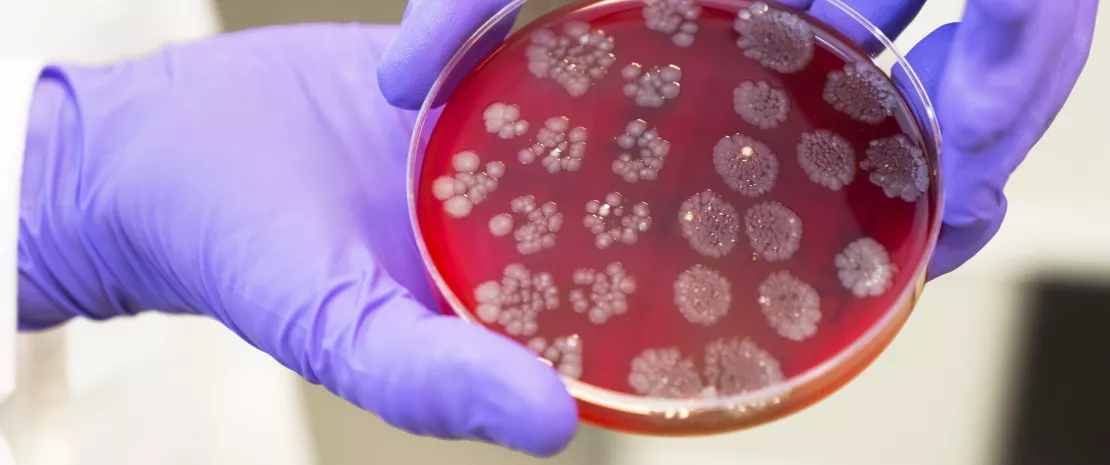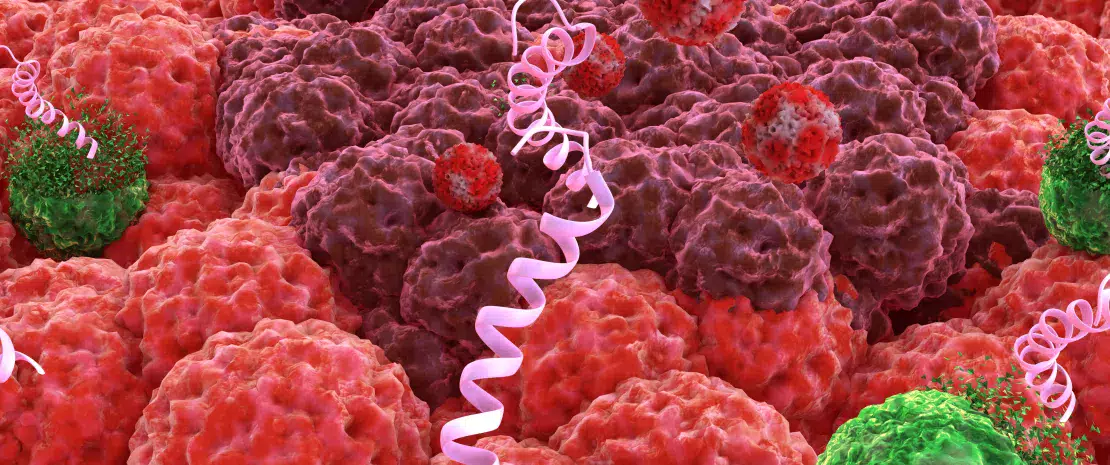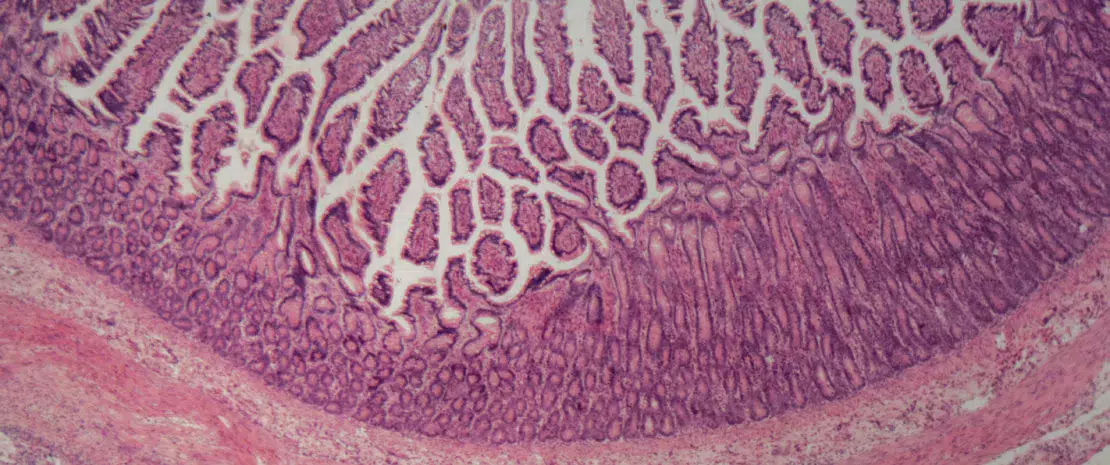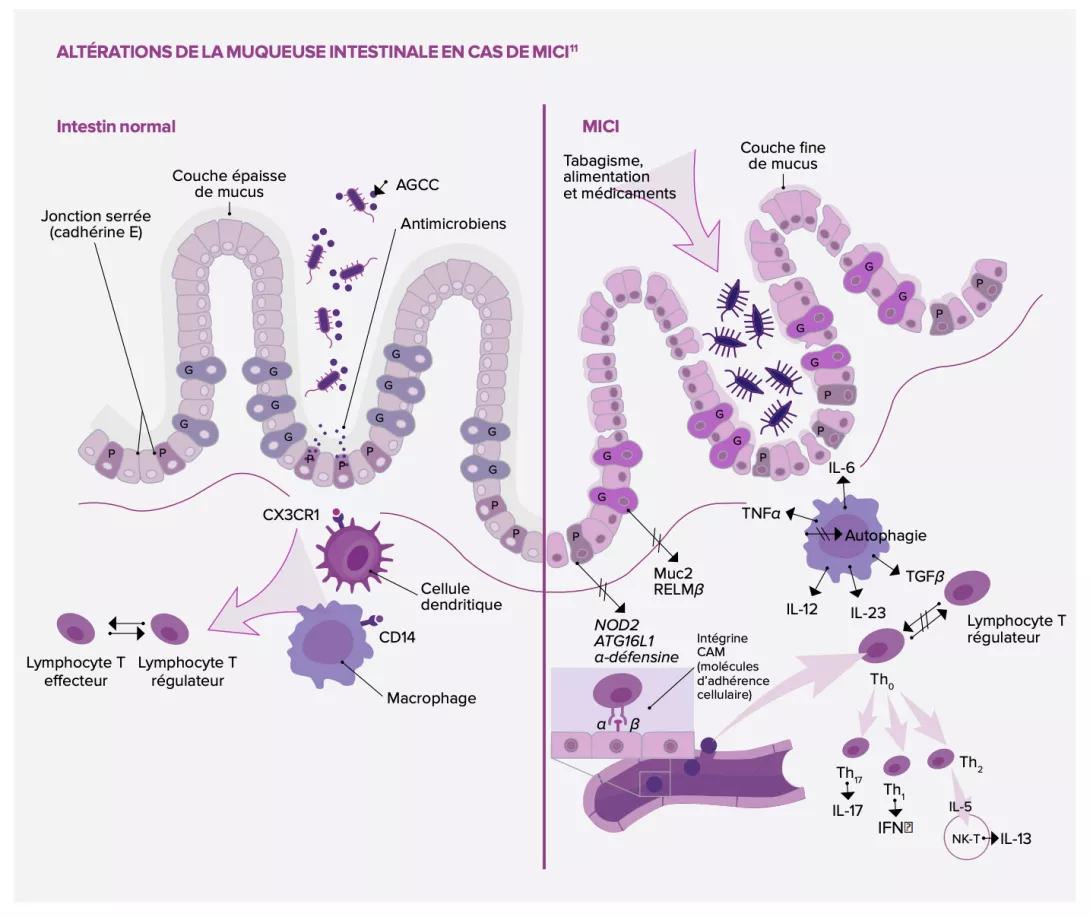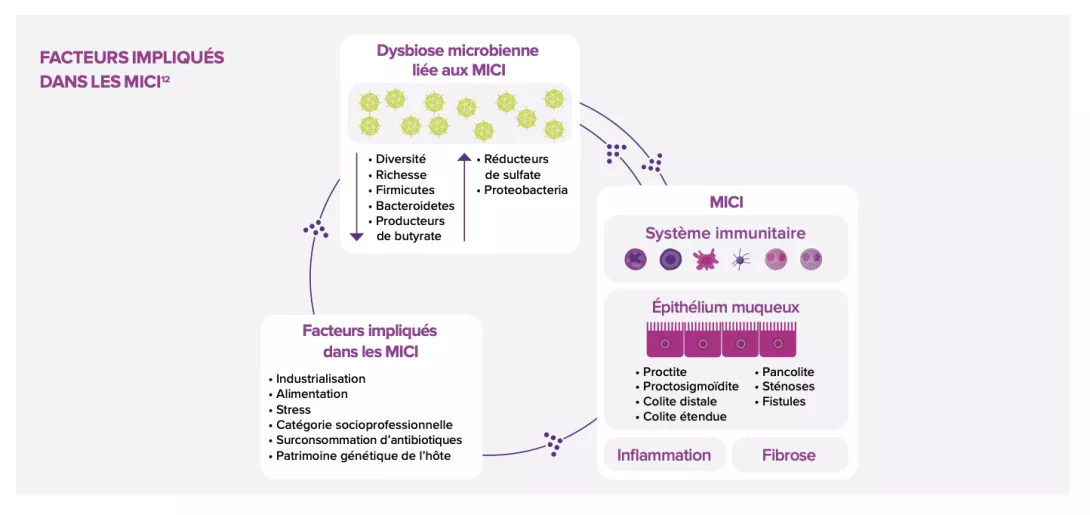Tous âges confondus, les gastroentérites sont essentiellement dues au norovirus. Mais chez les moins de cinq ans, les infections à rotavirus sont la première cause de diarrhée sévère et aiguë à travers le monde. Les pays pauvres paient le plus lourd tribut, malgré l’existence de vaccins et d’antiviraux.
Identifié en 1973, le rotavirus doit son nom à son architecture particulière en forme de roue3. Il en existe dix espèces différentes, dont la plus commune est la A. En plus de la diarrhée – non sanglante et de courte durée à la différence des diarrhées bactériennes –, l’infection provoque des vomissements qui contribuent à la déshydratation des patients et peuvent entraver l’efficacité des traitements. L’infection par rotavirus est en général plus sévère que les diarrhées provoquées par les autres agents infectieux : fièvre, malaises et fatigue traduisent la réaction défensive de l’organisme en réponse à l’infection. Au-delà d’une semaine ou si les diarrhées / vomissements s’aggravent, une consultation médicale et un traitement spécifique s’imposent. Possible tout au long de l’année, la transmission du rotavirus se fait essentiellement par contact direct ou indirect avec des personnes contaminées. Les complications sont rares mais possibles : s’il pénètre dans la circulation sanguine, l’agent peut provoquer des infections extra-intestinales, essentiellement neurologiques (méningite, encéphalite, encéphalopathie). L’introduction de la vaccination en 2006 à travers le monde a eu deux conséquences dans les pays riches : le vieillissement des personnes infectées (désormais des adolescents ou des personnes âgées de plus de 70 ans), et la saisonnalité des épidémies.
Gare à l’alimentation et à la proximité10 !
Extrêmement contagieux, hautement infectieux et relativement résistants aux désinfectants, les norovirus se transmettent essentiellement par l’ingestion d’aliments ou d’eau infectés, ou par contact avec des objets contaminés ou des personnes malades ; une contamination par voie aérienne est également possible. De simples cas isolés peuvent rapidement conduire à des épidémies dans les espaces confinés (bateaux de croisière, centres de soins, hôpitaux...) et les formes aiguës peuvent entraîner des complications intestinales graves (syndrome du côlon irritable post infectieux, une déshydratation sévère potentiellement mortelle, etc.) Dans les autres cas, les gastroentérites à norovirus durent entre un et quatre jours et entraînent les mêmes symptômes que celles dues à un rotavirus : douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées non sanglantes. Elles guérissent en général spontanément, mais l’élimination du virus peut prendre plusieurs mois chez les porteurs sains (infectés mais ne présentant aucun symptôme), et même plusieurs années chez les personnes dont les défenses immunitaires sont en berne ; devenant malades chroniques, ces dernières deviennent probablement des réservoirs épidémiques.