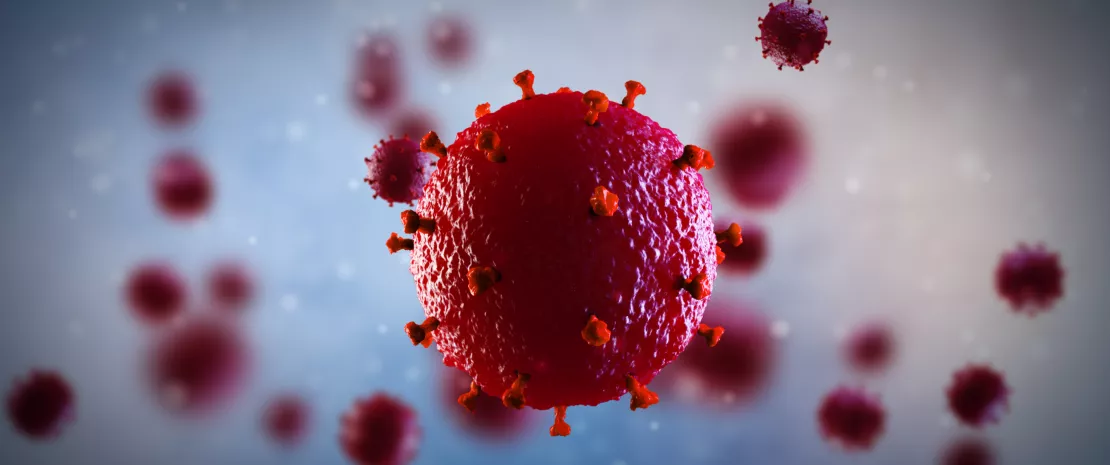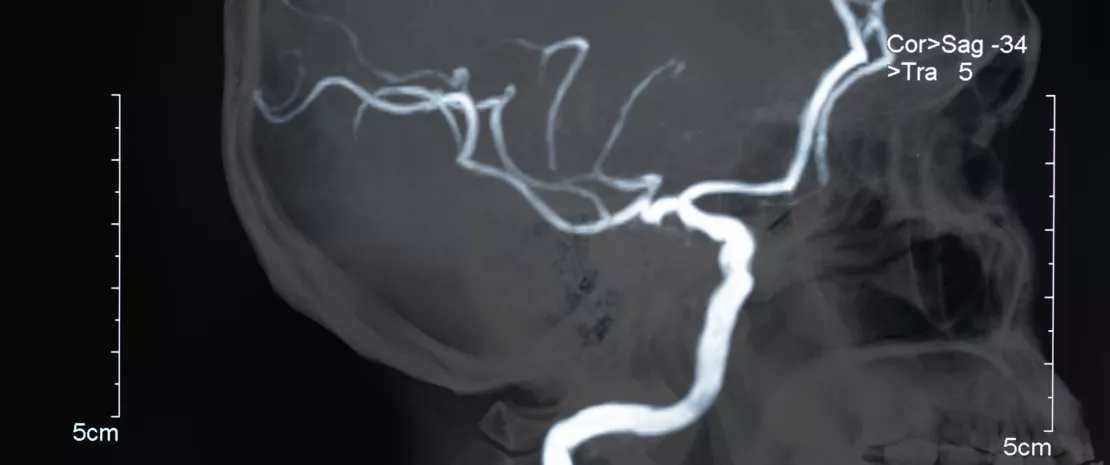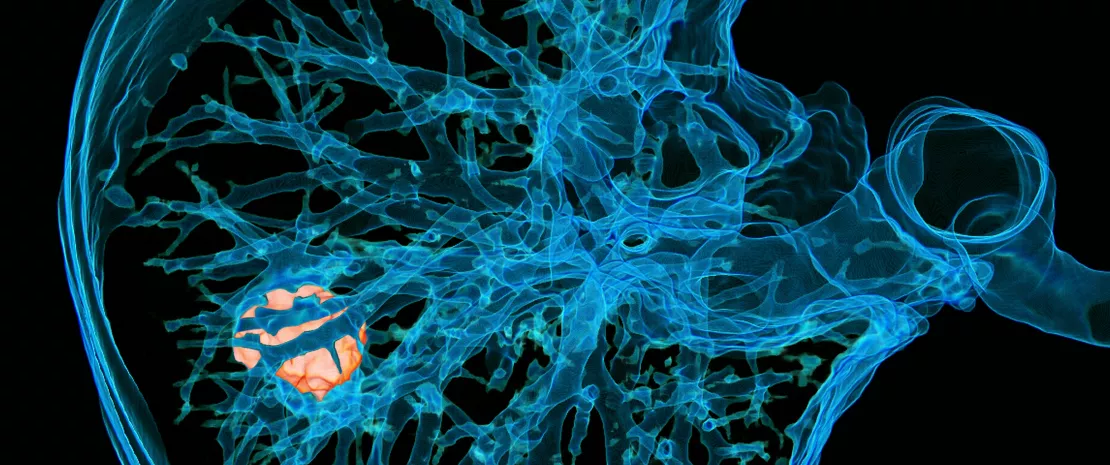La capacité du microbiote intestinal à communiquer à distance avec des organes, tels que le cerveau, le foie ou les poumons, est souvent rapportée dans la littérature, de même que des associations entre dysbiose et certaines maladies. Dans ce contexte, une équipe chinoise s’est intéressée aux spécificités du microbiote intestinal chez des patients atteints de tuberculose (TB), causée par Mycobacterium tuberculosis. Pour les caractériser, les chercheurs ont comparé le microbiote de 46 patients TB à celui de 31 sujets témoins par séquençage en shotgun*.
Un microbiote intestinal moins diversifié
Première observation : une richesse et une diversité bactériennes (indice de Shannon) significativement moindres dans le microbiote des patients TB. Celui-ci était également caractérisé par une présence réduite ou accrue de certaines espèces par rapport au groupe témoin. Ainsi, 23 espèces s’avéraient moins présentes dans le microbiote des patients TB, tandis que 2 étaient plus abondantes (unclassified Coprobacillus et Clostridum bolteae).
Autre constat marquant : parmi les 23 espèces bactériennes diminuées chez les patients TB, 9 produisent des acides gras à chaîne courte (AGCC), composés intervenant largement dans les réponses inflammatoires et immunitaires de l’organisme. En particulier, cinq espèces productrices de butyrate (Roseburia inulinivorans, R. hominis, R. intestinalis, Eubacterium rectale et Coprococcus comes), deux espèces productrices de lactate et d’acétate (Bifidobacterium adolescentis et B. longum) et deux espèces productrices d’acétate et de propionate (Ruminococcus obeum et Akkermansia muciniphila) étaient diminuées. En accord avec ces modifications de composition bactérienne, les fermentations d’AGCC se révélaient fortement réduites chez les patients TB.
Repérer les malades grâce à leur microbiote ?
Enfin, grâce à des travaux de modélisation, les chercheurs ont caractérisé 3 espèces bactériennes (Haemophilus parainfluenzae, R. inulinivorans et R. hominis) dont la présence pouvait prédire le statut malade/non malade des sujets. Certaines variations génétiques (SNP, pour Single Nucleotide Polymorphism) de B. vulgaris permettait également de distinguer les patients TB des témoins. Comme pour de nombreuses pathologies touchant différentes sphères (diabète de type 2, autisme, etc.), la tuberculose s’avère ainsi associée à une dysbiose du microbiote intestinal, sans néanmoins pouvoir déterminer s’il s’agit d’une cause ou d’une conséquence de la maladie ; les données mécanistiques actuellement disponibles chez l’animal rendant plausibles les deux hypothèses.
*Méthode de séquençage plus précise que le 16S