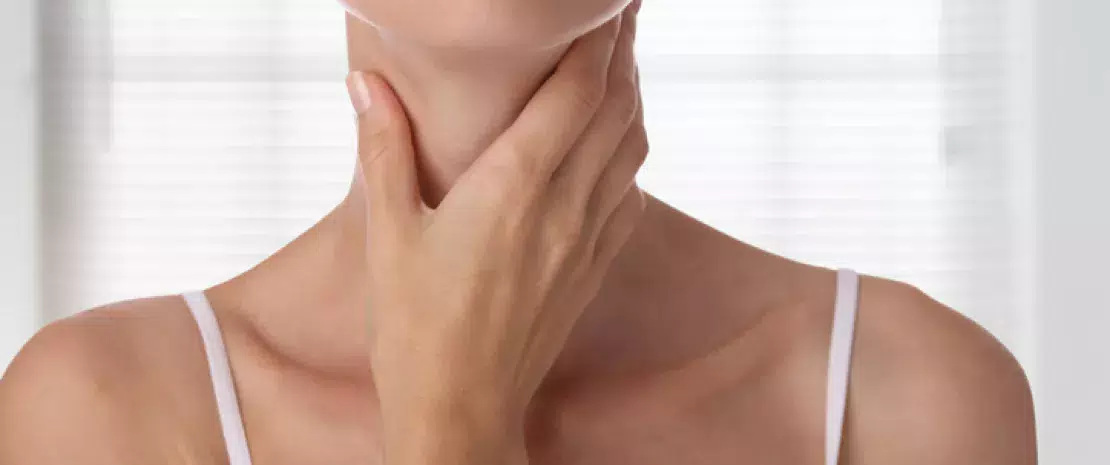Les troubles colorectaux consécutifs aux lésions chroniques de la moelle épinière affectent de façon majeure la qualité de vie de nombreux patient paraplégiques et tétraplégiques. Les perturbations du système nerveux autonome peuvent occasionner des troubles digestifs (inconfort, ballonnements, flatulences), mêler constipation chronique et incontinence fécale et nécessiter le recours à des médicaments ou techniques laxatives avec ou sans assistance. A tel point que chez certains patients, le désir d’améliorer ce dysfonctionnement intestinal neurologique surpasse celui de remédier à l’incontinence urinaire ou aux dysfonctionnements sexuels, voire même à la perte de la marche.
Des profils bactériens liés au handicap
Une équipe chinoise a analysé les selles de 43 hommes atteints de lésions médullaires traumatiques chroniques (23 paraplégiques, 20 tétraplégiques) et 23 hommes sans lésion. Le microbiote intestinal des participants handicapés différait de celui des contrôles : il était moins diversifié et plus abondant, notamment en Bacteroides, Blautia, Lachnoclostridium et Escherichia-Shigella. Par ailleurs, les profils bactériens présentaient des variations entre paraplégiques - plus riches par exemple en Acidaminococcaceae, Blautia, Porphyromonadaceae, et Lachnoclostridium - et tétraplégiques – plus abondants en Bacteroidaceae et Bacteroides - par rapport aux contrôles. Une proportion réduite en Alistipes semblerait être également associée à un allongement du temps de défécation chez les patients tétraplégiques.
Lipides sanguins et glycémie impactés
Pour compléter leurs observations, les chercheurs ont étudié les corrélations entre ces variations de populations bactériennes et certains facteurs environnementaux tels l’âge, l’IMC, et différents marqueurs sériques (CRP, glucose, enzymes hépatiques, lipides sanguins, urémie et acide urique, créatinine etc.). Les bactéries appartenant aux Bacteroides, plus nombreuses chez les tétraplégiques, étaient liées à de faibles taux de HDL, probablement en raison d'un manque d’activité physique. A l'inverse, les bactéries appartenant au genre Dialister, plus élevées chez les sujets sains, étaient négativement corrélés aux lipides sanguins (LDL, TG et cholestérol total). De fort taux sanguins de ces facteurs seraient donc signe d’aggravation des troubles colorectaux. Aux Megamonas correspondait une glycémie moins élevée, mais également un allongement du temps de défécation et une majoration des ballonnements, sans doute par fermentation des glucides non digérés mais fermentés par ces mêmes bactéries dans le côlon. Des Prevotella en faible proportion étaient elles aussi reliées à une glycémie plus faible (donc à un rôle bénéfique), même si d’autres études font mention d’effets pro-inflammatoires. Ces travaux mériteront d’être complétés par d’autres outils analytiques (analyse des communautés bactériennes plus précise, mesure de la sérotonine…), l’inclusion de femmes dans les cohortes, et l’étude de l’impact de l’immobilité en elle-même, potentiellement vectrice de dysbioses.