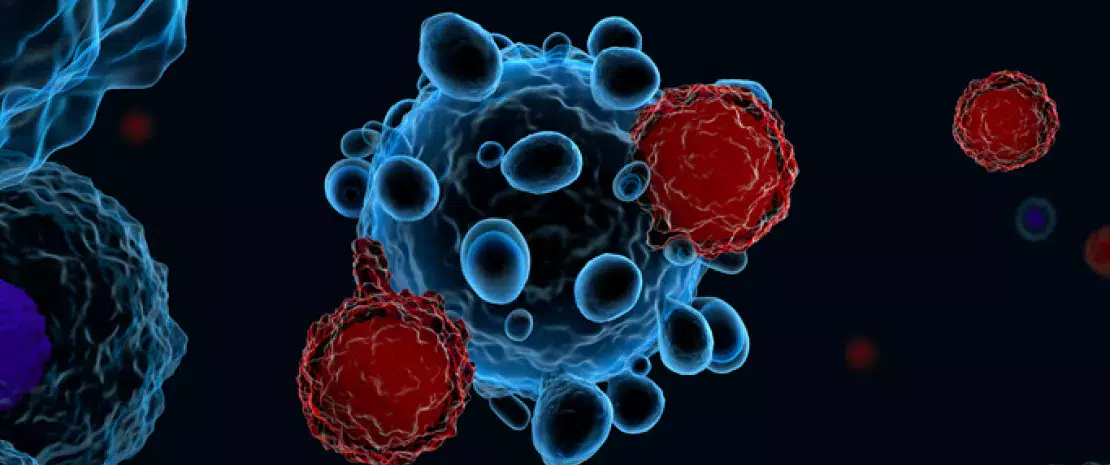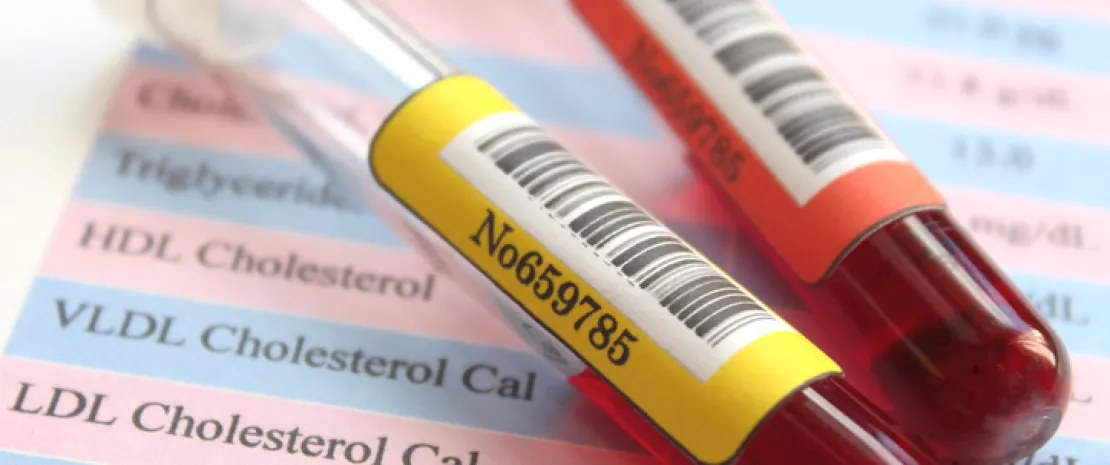Le microbiote intestinal a été impliqué dans de nombreuses maladies (obésité, diabète…), en cause métabolites et autres signaux microbiens influeraient le taux de lipides circulants, incluant triglycérides et HDL. De même, plusieurs études ont établi un lien entre ce microbiote et divers acides aminés incriminés dans le diabète et les maladies cardiovasculaires. Profitant des progrès de la métabolomique, une équipe a analysé la relation entre le microbiote intestinal et des métabolites circulants. Et ce, via la caractérisation du métabolome (ensemble des métabolites) de 2 309 individus issus de 2 cohortes prospectives (Rotterdam et LifeLines-DEEP). Il en ressort qu’au total, 32 groupes bactériens sont associés à certains métabolites circulants, après ajustement sur l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle (IMC) et les médicaments (dont des hypolipidémiants, des inhibiteurs de la pompe à protons et la metformine).
Microbiote et lipoprotéines
Ainsi, parmi les 32 taxons microbiens identifiés, 18 sont associés avec des particules VLDL (eux-mêmes associés à des maladies métaboliques, cardiaques et au diabète de type 2), et 22 autres avec des particules HDL (réputées protectrices), avec néanmoins des différences selon la taille des particules HDL, suggérant que cette classe de lipoprotéines est hétérogène dans ses fonctions métaboliques et effets (protecteur ou délétère). 13 taxons microbiens –certains réputés associés à l’IMC (Christensenellaceae), d’autres au métabolisme biliaire (Clostridiaceae1), etc. – étaient à la fois associés à des particules VLDL et HDL. En revanche, la faible association du microbiote intestinal avec les LDL et IDL* suggère des relations distinctes selon les classes de lipoprotéines. Enfin, 15 groupes bactériens, dont Ruminococcus gnavus group (signe d’une faible richesse du microbiote et plus présent chez les patients souffrant d’athérosclérose) étaient associés aux triglycérides sériques.
Corps cétoniques, acides aminés…
En outre, des associations sont rapportées entre le microbiote intestinal et :
• des corps cétoniques, notamment l'acétate un acide gras à chaîne courte (AGCC) produit par les bactéries coliques qui favoriserait le syndrome métabolique
• des acides aminés dont l'isoleucine, associée aux diabète et maladies cardiovasculaires
• des marqueurs d’une réaction inflammatoire en phase aiguë, notamment des glycoprotéines impliquées dans les maladies inflammatoires et le cancer, et associées aux maladies cardiovasculaires
Selon les auteurs, les mécanismes potentiels par lesquels le microbiote intestinal affecterait les taux de lipides circulants pourraient impliquer les acides biliaires et les AGCC. Le cas échéant, le microbiote intestinal pourrait devenir une cible potentielle pour des interventions curatives et préventives.
* intermediate density lipoprotein