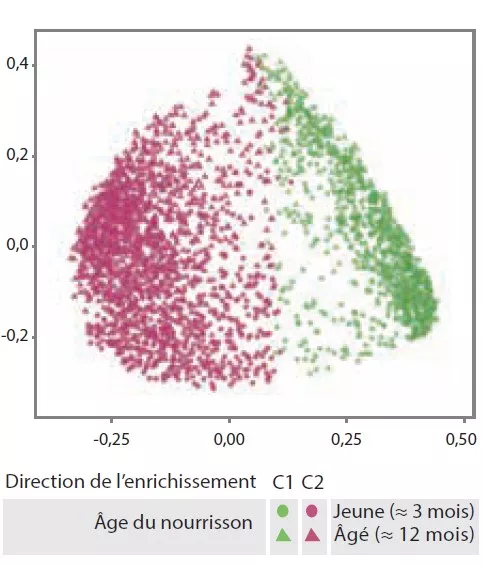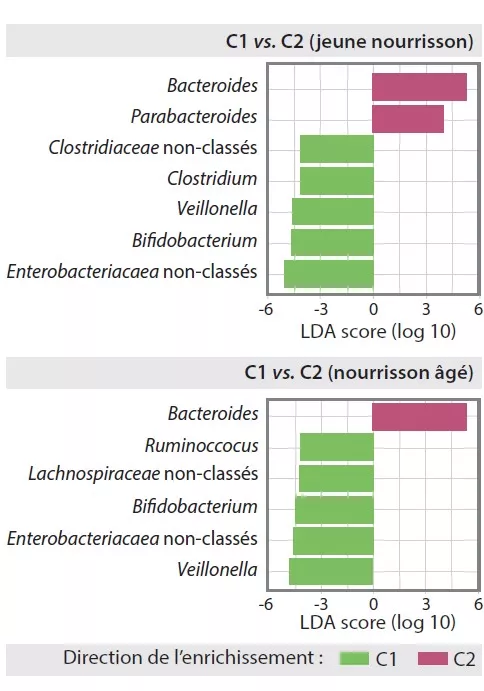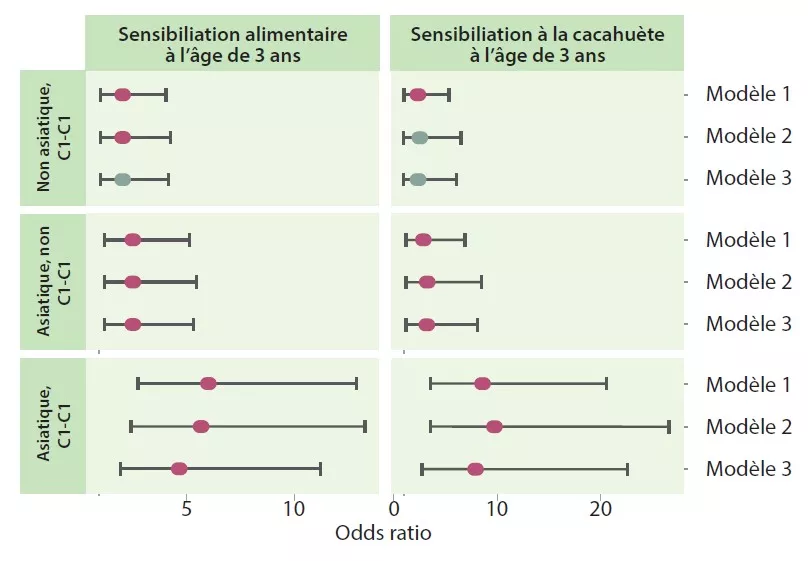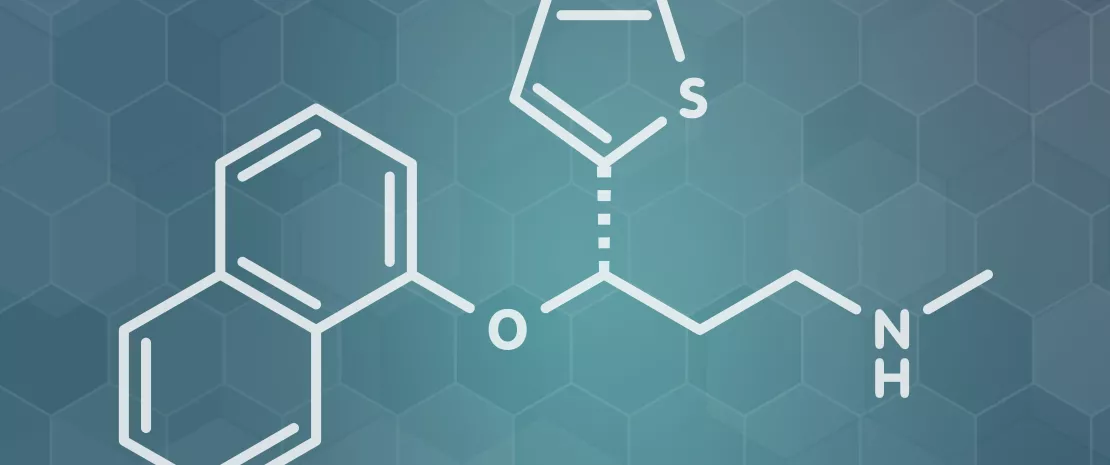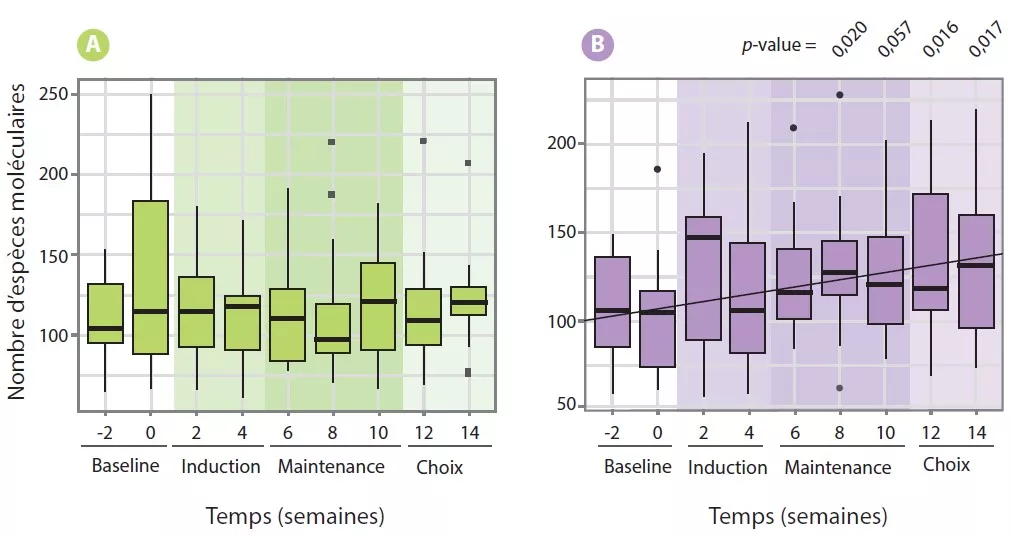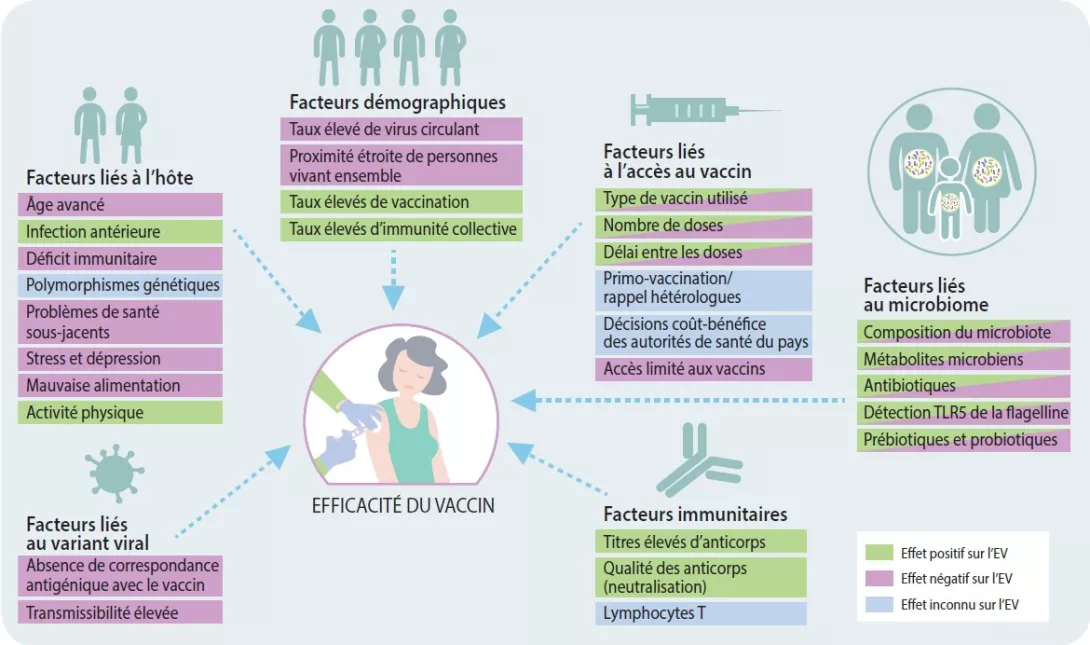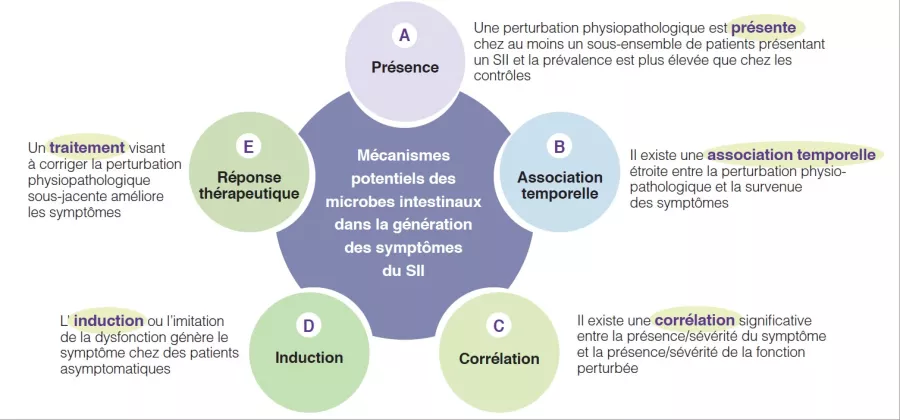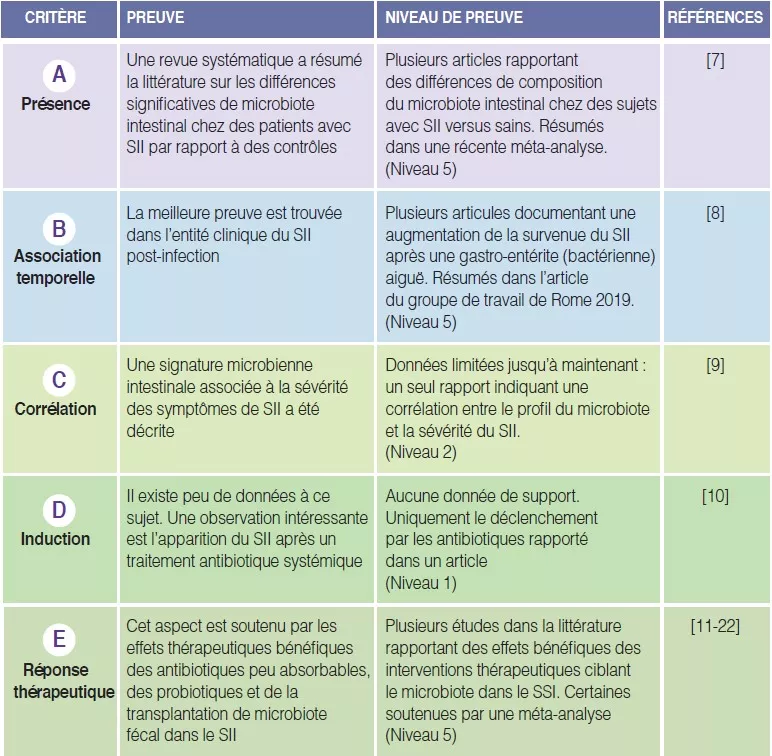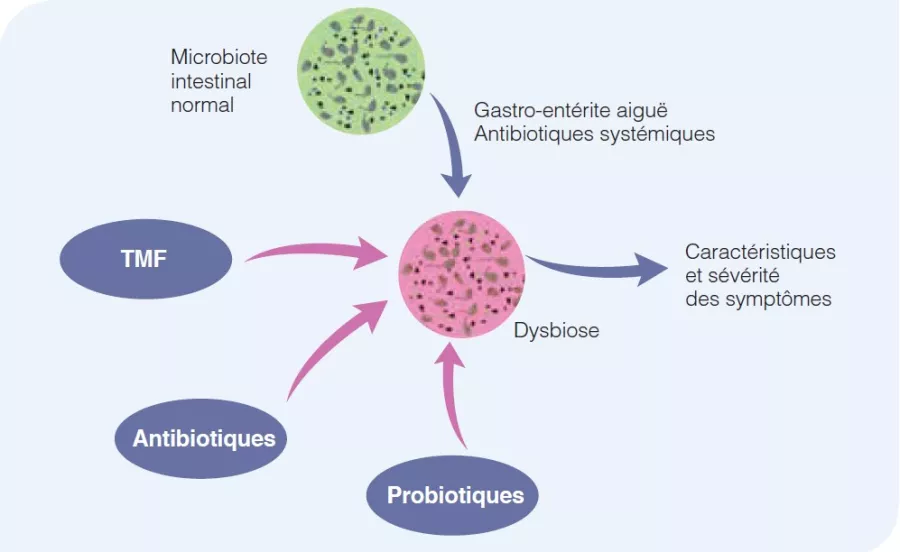Microbiote vaginal #14
par le Pr. Markku Voutilainen
Faculté de médecine de l'Université de Turku ; gastro-entérologie, Hôpital universitaire de Turku, Finlande

Le microbiote vaginal doit-il être considéré comme responsable de la dysménorrhée ?
Dans une étude pilote, la première à s’intéresser au lien entre la composition du microbiote vaginal pendant les règles et l’intensité de la douleur menstruelle, 20 femmes ont été classées en trois groupes en fonction de la douleur ressentie pendant leurs règles : « douleur localisée légère », « douleur localisée sévère » ou « douleur multiple sévère et symptômes gastro-intestinaux ». Le microbiote vaginal a été analysé pendant les règles et en dehors. Les résultats ont montré que la composition du microbiote vaginal varie significativement entre les femmes, ainsi qu’au cours du cycle menstruel, mais que la composition pendant les règles varie encore plus en fonction de l’intensité de la douleur. En particulier, pendant les règles, les femmes ayant une dysménorrhée plus sévère présentaient moins de lactobacilles et davantage de bactéries potentiellement pro-inflammatoires. Bien que limitée en termes de taille, de groupes d’âge étudiés et de diversité ethnique, cette étude pilote constitue une première étape vers des études plus larges sur les associations entre l’intensité de la douleur pendant les règles et la composition du microbiote vaginal. Les chercheurs émettent l’hypothèse que pendant les règles, le tissue endométrial est dégradé, libérant des composés (prostaglandines) qui peuvent causer des contractions musculaires utérines et une sensibilité accrue et contribuer ainsi à la douleur menstruelle. Certaines bactéries du microbiote vaginal pourraient favoriser la libération de ces composés et de cytokines pro-inflammatoires, qui exacerbent les symptômes de dysménorrhée. Si ces hypothèses sont confirmées, l’étude pilote soulignerait l’importance de la prise en compte des différences inter- individuelles et de la dynamique du microbiote vaginal pendant le cycle menstruel.
Microbiote cervicovaginal : un marqueur d'infection permanente à papillomavirus ?
Dans cette nouvelle étude, le microbiote cervicovaginal de 15 femmes a été analysé par séquençage génétique de l’ARNr 16S, et un génotypage du HPV a été réalisé. Six des femmes ont montré une infection persistante (avec le même type de HPV pendant plus de 12 mois), quatre ont montré une infection transitoire (qui a disparu en moins 12 mois) et cinq étaient négatives pour le HPV. Les trois groupes ont montré des différences significatives en ce qui concerne la composition du microbiote. Chez les femmes saines et celles présentant une infection transitoire, le genre Lactobacillus prédominait, tandis que les femmes avec infection persistante avaient un microbiote cervicovaginal plus varié. Une analyse statistique a révélé que 36 bactéries étaient associées à un statut infectieux transitoire ou persistant et que ces bactéries pouvaient potentiellement servir de biomarqueurs. Parmi celles-ci, conformément aux précédentes études, les genres Acinetobacter, Prevotella et Pseudomonas étaient corrélés avec une infection persistante. Lactobacillus iners était quant à lui corrélé à une infection transitoire. Les femmes présentant un infection persistante à HPV avaient des concentrations significativement supérieures d’IL-6 et de TNF-α dans leurs sécrétions cervicales et un nombre plus élevés de lymphocytes T régulateurs et de cellules suppressives dans le sang périphérique. Les résultats de cette étude suggèrent que les modifications du microbiote cervicovaginal pourraient être liées à une infection persistante à HPV. Toutefois, on ne sait pas si la dysbiose induit une persistance de l’infection ou inversement. Malgré cela, l’identification d’une signature microbienne pour l’infection persistante à HPV pourrait permettre un diagnostic plus précoce, conduisant à une intervention plus précoce pour éradiquer l’infection et réduire la probabilité de développement de lésions cervicales malignes.