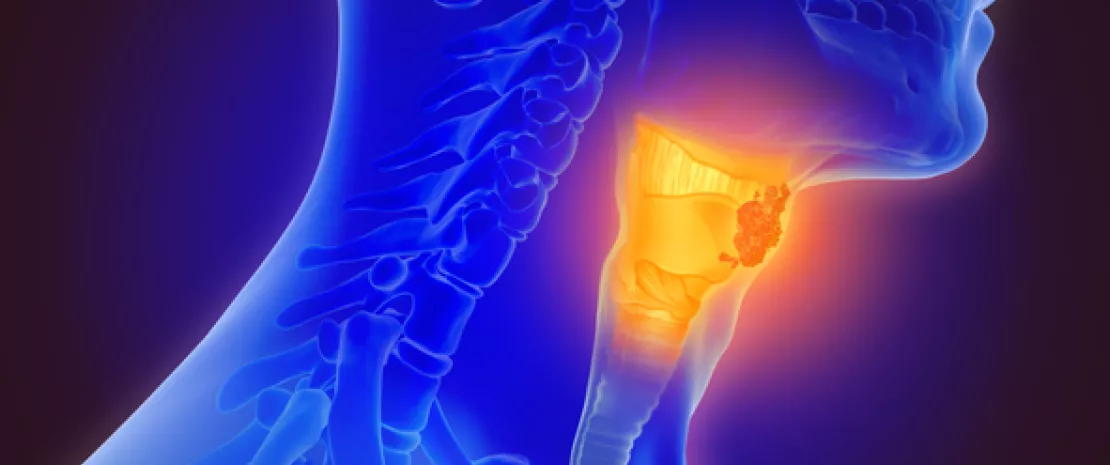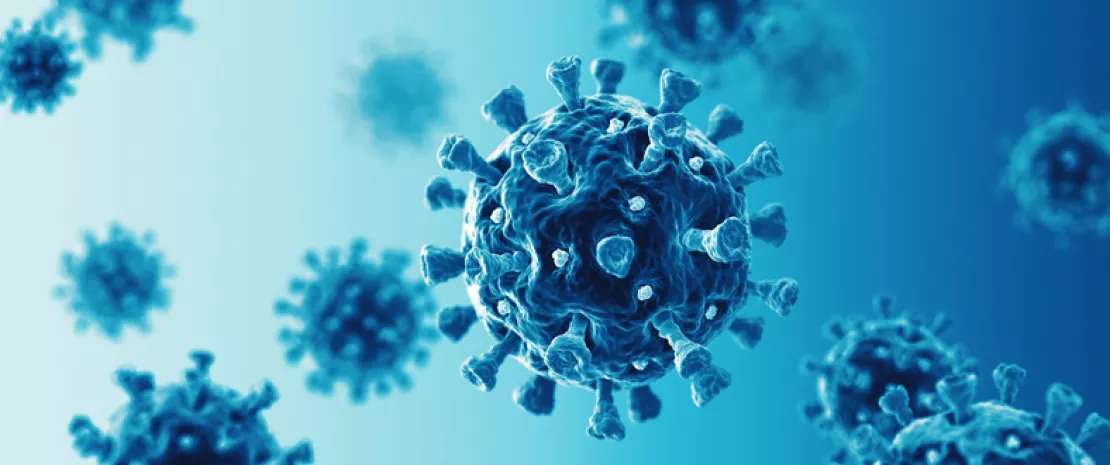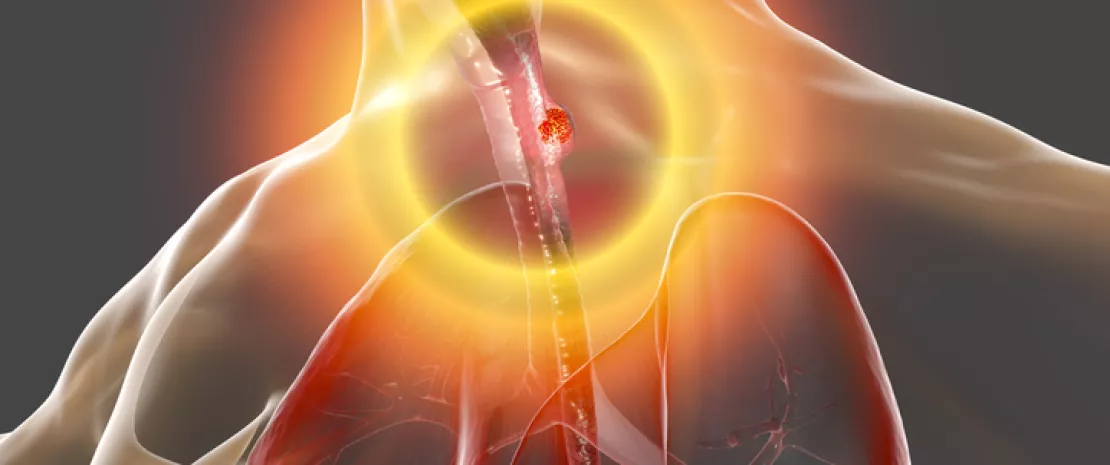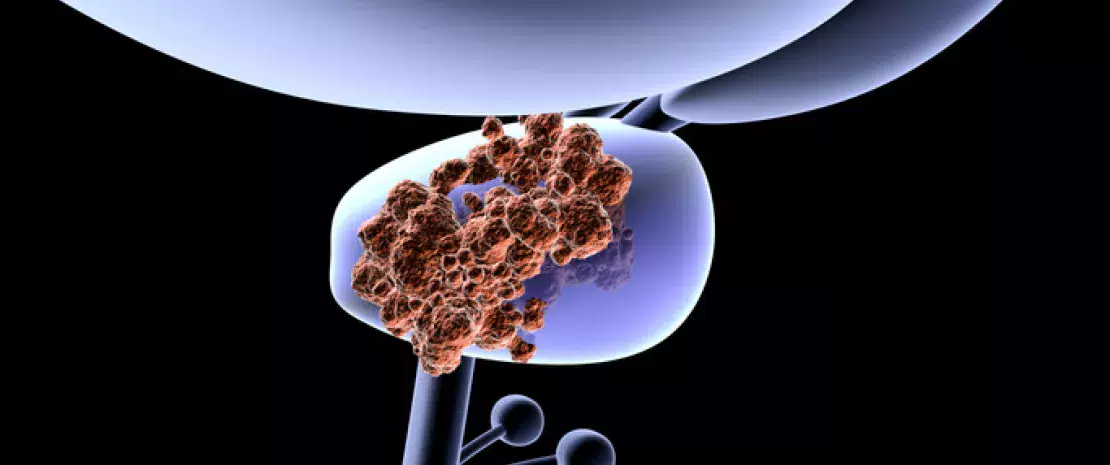Les thérapies conventionnelles conçues pour priver l’organisme d’androgènes, responsables de la croissance du cancer de la prostate, ne sont pas toujours efficaces. L’acétate d’abiratérone (AA) est dans ce cas envisagé, et à la différence des autres traitements, il est pris par voie orale. Ce traitement étant peu absorbé, une portion non négligeable est excrétée dans les selles et interagirait au niveau du microbiote intestinal. Plusieurs études ont mis en évidence le rôle du microbiote intestinal dans le développement et la progression de certains cancers, ainsi que dans l'efficacité des traitements. Cependant, les connaissances de l’implication du microbiote intestinal dans le cancer de la prostate restent limitées. Ainsi les chercheurs ont cherché à démontrer comment l’acétate d’abiratérone (AA), très efficace dans ce type de cancer résistant aux thérapies conventionnelles, impactait le microbiote intestinal, et si celui-ci pouvait agir sur la réponse au traitement.
La privation d’androgènes induit le remodelage du microbiote intestinal
Pour cela, ils ont examiné la composition du microbiote intestinal par séquençage de l’ARNr 16S de 68 patients atteints du cancer de la prostate et répartis en trois groupes :
- patients ne recevant pas de traitement (n=33) ;
- patients recevant la thérapie conventionnelle (n=21) ;
- patients recevant la thérapie conventionnelle + l’AA (n=14).
La privation d’androgènes par la thérapie conventionnelle seule ou additionnée à l'AA a conduit à une réduction significative des Corynebacterium, des bactéries pro-inflammatoires métabolisant les androgènes comme la testostérone, comparativement au groupe contrôle. La prise d'AA induisait un enrichissement significatif d’Akkermansia muciniphila, accompagnée d’une augmentation la production de vitamine K2, connue pour ses propriétés antitumorales.
Rôle capital d’A. muciniphila dans la réponse aux traitements
Ces résultats ont été confirmés dans un modèle intestinal excluant ainsi la possibilité d’une implication immunitaire. Des investigations révèlent que l’AA serait métabolisé par les bactéries intestinales. Les composants issus de cette dégradation auraient un impact sélectif sur le microbiote intestinal caractérisé par la croissance d’A. muciniphila. Cette espèce reconnue pour ses bénéfices sur la santé et ses propriétés anti-inflammatoires est supposée jouer un rôle primordial dans la réponse au traitement d’après les auteurs. De précédents travaux avaient d’ailleurs mis en évidence son rôle bénéfique dans la réponse aux traitements de certaines immunothérapies. Cette étude met en évidence le rôle clef du microbiote intestinal dans la réponse à un traitement anti-cancéreux pris par voie orale, par le biais de mécanismes qui doivent être encore précisés. Explorer les interactions médicament-microbiote pourrait permettre d’améliorer les résultats de traitements de nombreuses maladies.