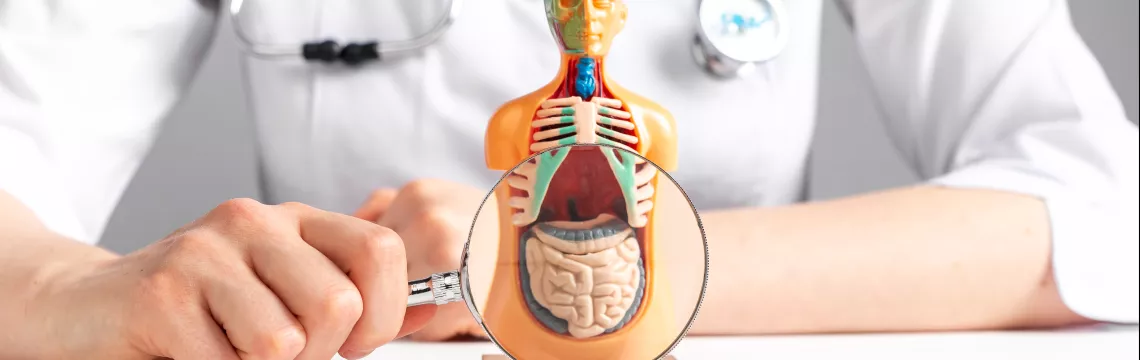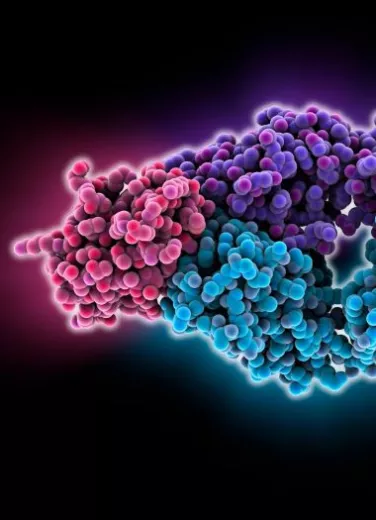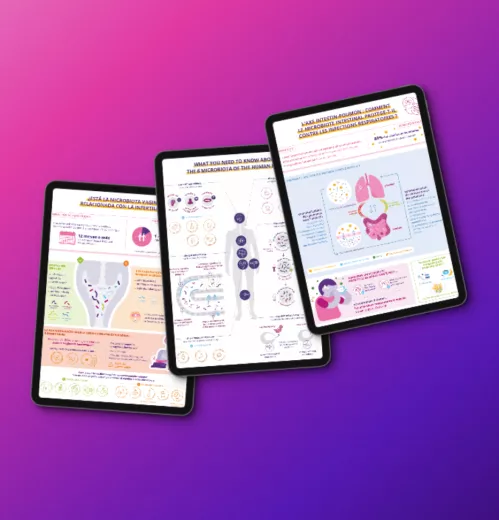Bienvenue sur le site web de l’Institut du Microbiote Biocodex !
Ce site web est destiné aux professionnels de santé et au grand public.
Information importante
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après, « les CGU ») ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition et d'utilisation des contenus et services du site internet de l’Institut du Microbiote Biocodex, accessible à l’adresse www.biocodexmicrobiotainstitute.com (ci-après, « le Site ») entre BIOCODEX - éditeur du Site (ci-après, « l'Editeur ») et l'utilisateur du Site (ci-après, « l'Utilisateur »).
L'accès au Site et à son contenu, ainsi que l'utilisation des services proposés par le Site, impliquent l'acceptation sans réserve par l'Utilisateur des présentes CGU. Sans acceptation de sa part, l’Utilisateur n’est pas autorisé à accéder au Site.
Les CGU pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, l'Utilisateur est invité à les consulter régulièrement.
Objet du Site et accès aux services
Le Site est destiné à fournir des informations utiles pour mieux comprendre les différents microbiotes et leur importance pour la santé humaine. Son contenu a été rédigé par une équipe de concepteurs et de rédacteurs non professionnels de la santé sur la base d'ouvrages de référence et de données bibliographiques. Le contenu a été validé par du personnel de santé qualifié.
Les informations fournies par le Site ne remplacent en aucun cas un avis médical.
Le Site est accessible en tout lieu et à tout Utilisateur disposant d'une connexion internet. Tous les frais liés à l'accès au Site (matériel informatique, logiciels, connexion internet, etc.) sont à la charge de l'Utilisateur.
L'Editeur met en œuvre tous les outils à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Site et à ses services. Il s'agit toutefois d'une obligation de moyens et non de résultat : l'Utilisateur s'engage donc à ne réclamer aucune indemnité à l'Editeur et à ses fournisseurs, dans l'hypothèse où le Site ne serait pas disponible au moment où l'Utilisateur souhaite y accéder.
L'accès au Site et à ses services peut, à tout moment et sans préavis, être interrompu, suspendu ou modifié, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison.
L'Editeur ne sera pas responsable des dommages résultant d'interférences, d'interruptions, de virus informatiques, de dysfonctionnements ou de déconnexions du terminal qui pourraient empêcher temporairement l'accès ou la navigation de l'Utilisateur.
Bien que l'Editeur ait apporté le plus grand soin à la réalisation du Site, celui-ci peut néanmoins contenir des inexactitudes. L'Utilisateur est invité à faire part à l'Editeur de toute suggestion d'optimisation.
Responsabilités
Tout contenu présent sur le Site a une valeur informative ou éducative. En aucun cas il n’a pour objectif de se substituer à l’avis ou à l’expertise d’un professionnel de santé.
L'Editeur s'efforce de fournir des informations de qualité et vérifiées. Toutefois, les sources d'information ne peuvent être totalement garanties.
Les possibles liens "sortants" présents sur le Site permettent à l'Utilisateur d'accéder à des informations et autres ressources complémentaires disponibles sur internet, ou de partager des informations sur les réseaux sociaux. L'Editeur ne dispose d'aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers totalement indépendants et ne peut donc être tenu pour responsable des conséquences de l'accès à ces sites tiers et à leur contenu.
L'Utilisateur ne peut mettre en place un lien hypertexte vers le Site qu'avec l'autorisation formelle et préalable de l'Editeur.
Propriété intellectuelle
Le Site est protégé par le droit de la propriété intellectuelle.
Le Site, tous les éléments qui le composent (tels que les logos, les textes, les photographies, les images, les fichiers PDF, les vidéos...), ainsi que le(s) nom(s) de domaine, sont la propriété exclusive de l'Editeur.
La duplication ou la reproduction partielle ou intégrale du Site ou de l'un quelconque des éléments qui le composent n'est autorisée qu'à des fins d'usage privé. Toute duplication ou reproduction partielle ou totale du Site ou de l'un de ses éléments constitutifs sur quelque support et de quelque manière que ce soit à d'autres fins et notamment commerciales sans autorisation formelle de l'Editeur et/ou du titulaire des droits est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée pénalement.
Les marques et logos figurant sur le Site sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. Par ailleurs, les images figurant sur le Site sont protégées par le droit d'auteur. Toute reproduction partielle ou totale de ces images, marques ou logos à partir des éléments du présent site Internet n'est pas autorisée sans l'accord préalable et écrit de l'Editeur.
Vigilance sanitaire
Pour signaler un effet indésirable, ainsi que toute question médicale ou réclamation concernant la qualité d’un produit, veuillez utiliser le Centre de notification de BIOCODEX accessible à l'adresse https://www.biocoreport.com/
Protection des données
Etant établi au sein de l’Union européenne, l’Editeur s’engage à se conformer à la réglementation applicable à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 – règlement général sur la protection des données (RGPD).
Afin de savoir comment sont traitées ses données et de quelle manière il peut exercer ses droits, l’Utilisateur est invité à prendre connaissance de la Politique de protection des données du Site via le lien permanent situé en pied de page.
Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes CGU sont régies par le droit français. Tout conflit ou divergence d’interprétation sera soumis à la compétence des tribunaux français.

 Tout ce que vous devez savoir à propos des probiotiques
Tout ce que vous devez savoir à propos des probiotiques
 Obésité : un acide gras bactérien impliqué ?
Obésité : un acide gras bactérien impliqué ?