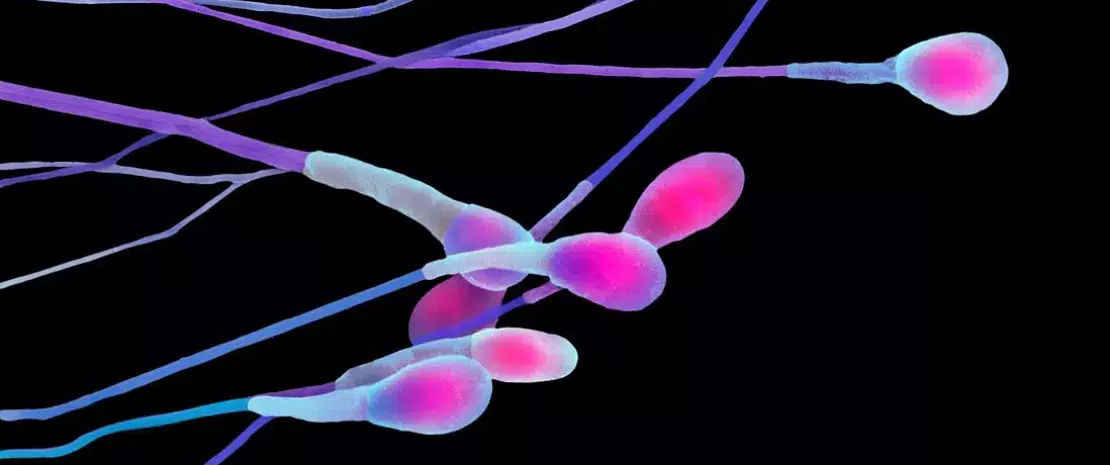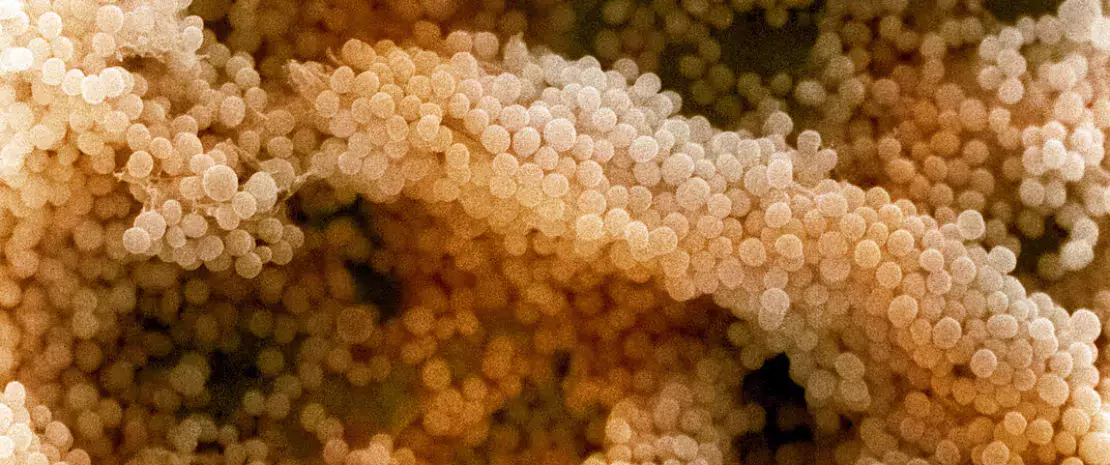Mois de sensibilisation au syndrome de l’intestin irritable (SII) 2024
Plus de 10 000 outils de diagnostic du SII ont été distribués dans le monde entier afin d’améliorer le diagnostic de la maladie et d’aider les médecins à mieux communiquer avec leurs patients.

10 000 outils de diagnostic du SII distribués dans le monde entier à l’occasion de congrès et de colloques
15 000 outils de diagnostic du SII réimprimés
300 outils de diagnostic du SII téléchargés sur le site web de l’Institut
Un an après son lancement par trois gastro-entérologues internationaux, l’outil de diagnostic du SII continue sur sa lancée. À l’occasion du Mois de sensibilisation au SII, le Biocodex Microbiota Institute va plus loin en proposant aux professionnels de santé et au grand public un parcours dédié permettant de mieux comprendre le SII et ses liens avec le microbiote.
Depuis 1997, avril est le mois de sensibilisation au syndrome de l’intestin irritable (SII). Le SII est une maladie complexe dont l’origine est souvent multifactorielle et qui n’est pas encore parfaitement comprise. Toutefois, un certain nombre d’éléments pointent du doigt le rôle du microbiote dans le SII. C’est pourquoi, durant ce mois, le Biocodex Microbiota Institute se joint aux malades, aux professionnels de santé et aux familles pour mieux faire connaître le SII et ses liens avec le microbiote intestinal. Témoignages de patients, interviews d’experts, infographies, formations accréditantes, articles... Autant d’outils permettant d’accroître la visibilité du SII et du microbiote.
L’outil de diagnostic du SII: une ressource précieuse pour les médecins
Lancé en 2023 par trois gastro-entérologues de renommée internationale le professeur Jean-Marc Sabaté, le professeur Jan Tack et le docteur Pedro Costa Moreira avec le soutien du Biocodex Microbiote Institute, l’outil de diagnostic du SII propose aux médecins un aide-mémoire pratique qui facilite le diagnostic différentiel (critères de diagnostic, sous-types de SII, signaux d’alerte, etc.) et permet d’améliorer la communication avec les patients.
Des milliers de gastro-entérologues, mais aussi des médecins de famille, des pharmaciens et des diététiciens ont déjà adopté cet outil innovant. Disponible en trois formats différents, cet outil a reçu l’aval de l’Organisation Mondiale de Gastro-entérologie (WGO).
On peut le télécharger ici.

« Cet outil facilite le processus de diagnostic de manière très pratique lorsque le médecin se retrouve devant son patient. »
Infographie sur le SII, dossier thématique et formations accréditantes : des offres de formation sur mesure !
De nombreux patients atteints du SII souffrent en silence pendant des années avant de se décider à parler de leurs symptômes à leur médecin. Pourtant, de par leur position centrale dans le suivi médical des patients, les médecins jouent un rôle crucial dans le diagnostic rapide du SII et son traitement efficace. Ils sont également bien placés pour établir des relations ouvertes et de confiance avec leurs patients. C’est pourquoi le Biocodex Microbiota Institute met à disposition des professionnels de santé des outils et des contenus personnalisés leur permettant d’améliorer leur pratique quotidienne et de se convertir rapidement en véritables experts du SII. Formation accréditante sur le SII, infographies à partager avec les patients, vidéos d’experts, dossier thématique, mais aussi dernières actualités scientifiques... Autant de contenus innovants, actualisés et faciles à utiliser pour devenir un authentique expert du SII.
Mieux comprendre le lien complexe entre microbiote et SII
Quels sont les principaux symptômes du SII ? Pourquoi développe-t-on le SII ? Est-il lié au microbiote ? Existe-t-il un axe microbiote-intestin-cerveau ? Afin de sensibiliser le grand public au SII et de répondre à toutes les questions qu’il pourrait se poser, le Biocodex Microbiota Institute donne la parole à un expert en la matière, le professeur Premysl Bercik, médecin chercheur à l’Université McMaster au Canada.

« Au cours de la dernière décennie, le microbiote intestinal a fait l’objet d’une attention croissante en tant que facteur clé du SII. »
Vivre avec le SII : témoignages de patients
Aline, Jennifer et Mihai sont des malades atteints du SII. Dans une série de témoignages vidéo, ils parlent ouvertement de la façon dont la maladie a changé leur vie et donnent des conseils pour mieux vivre avec le SII. Les premiers épisodes de « Patient Stories » ont été produits avec le soutien de l’Association des Patients Souffrant du Syndrome de l’Intestin Irritable (APSSII). Ils sont accessibles ici.
Avec cette campagne de sensibilisation tous azimuts, le Biocodex Microbiota Institute entend encourager activement tous les acteurs (patients et professionnels de santé, mais aussi familles, aidants, autorités sanitaires, grand public, etc.) à mieux comprendre la maladie elle-même et les dernières avancées de la recherche sur le rôle joué par le microbiote intestinal.
S’il reste encore du chemin à parcourir en termes de prise en charge du SII et de traitement des symptômes, il ne fait guère de doute que le développement de nouveaux outils de diagnostic changera bientôt la donne.

« Cela fait longtemps que je travaille dans ce domaine et j’ai pu constater comment a évolué la perspective sur le SII. Il y a trente ans, on pensait qu’il s’agissait sans doute d’une maladie psychosomatique. Aujourd’hui, nous sommes pleinement conscients qu’il s’agit d’un trouble aux répercussions importantes que nous devons traiter correctement. »
À propos du Biocodex Microbiota Institute
Le Biocodex Microbiota Institute est un carrefour international de connaissances ayant pour but de promouvoir une meilleure santé en communiquant sur le microbiote humain. Pour ce faire, il s’adresse aux professionnels de santé ainsi qu’au grand public afin de les sensibiliser au rôle central de cet important organe.
Contact presse Biocodex Microbiota Institute
Olivier Valcke
Relations publiques et responsable éditorial
+33 6 43 61 32 58
o.valcke@biocodex.com