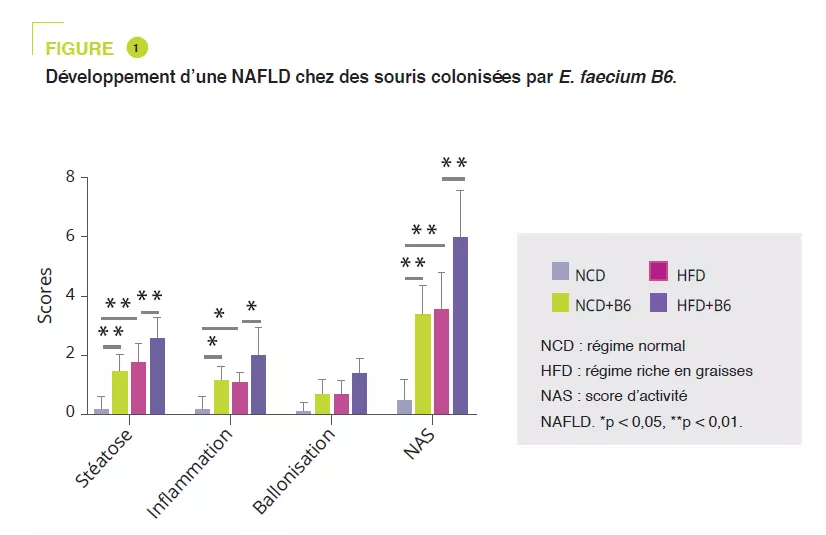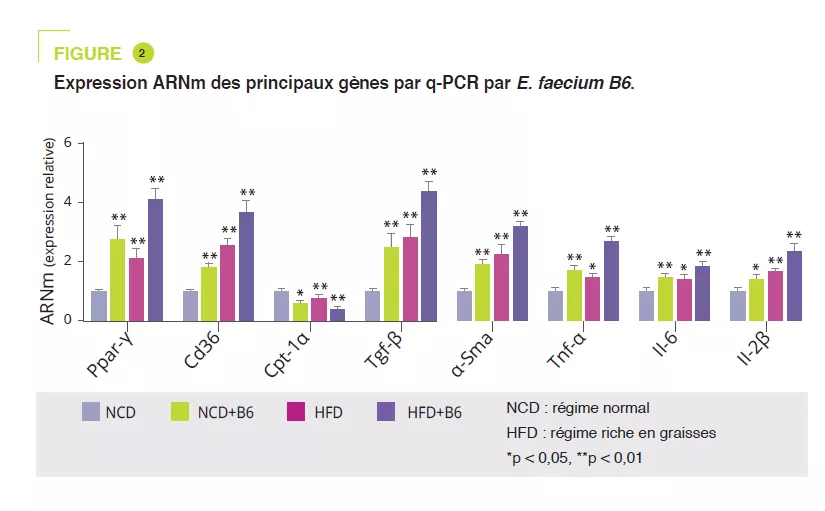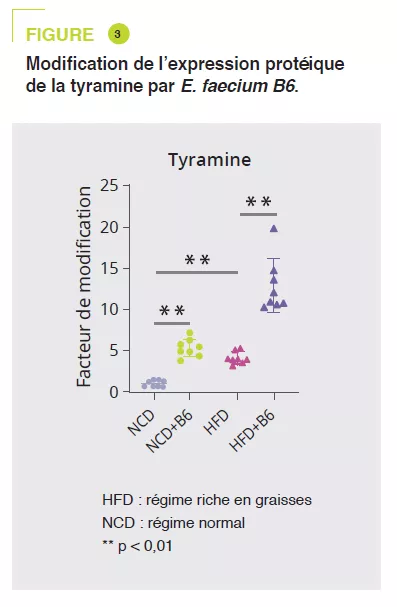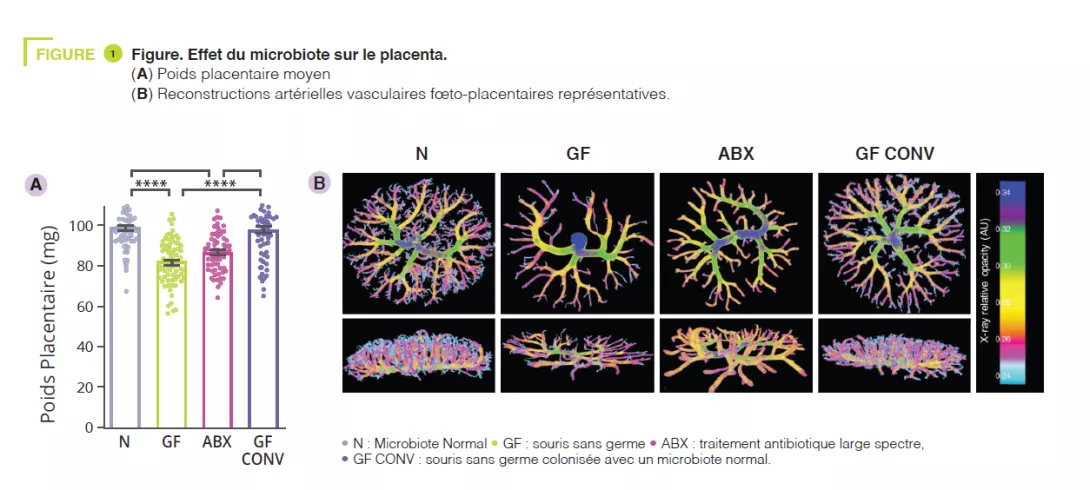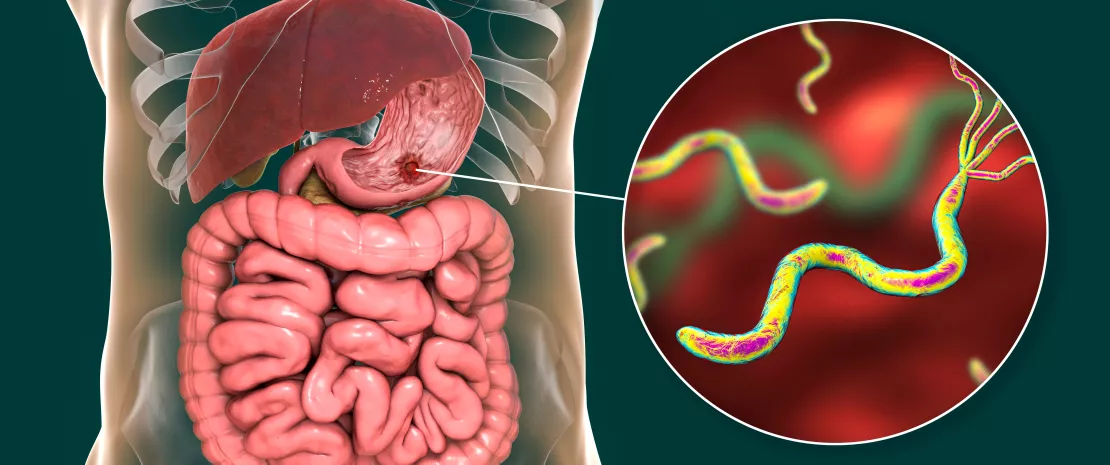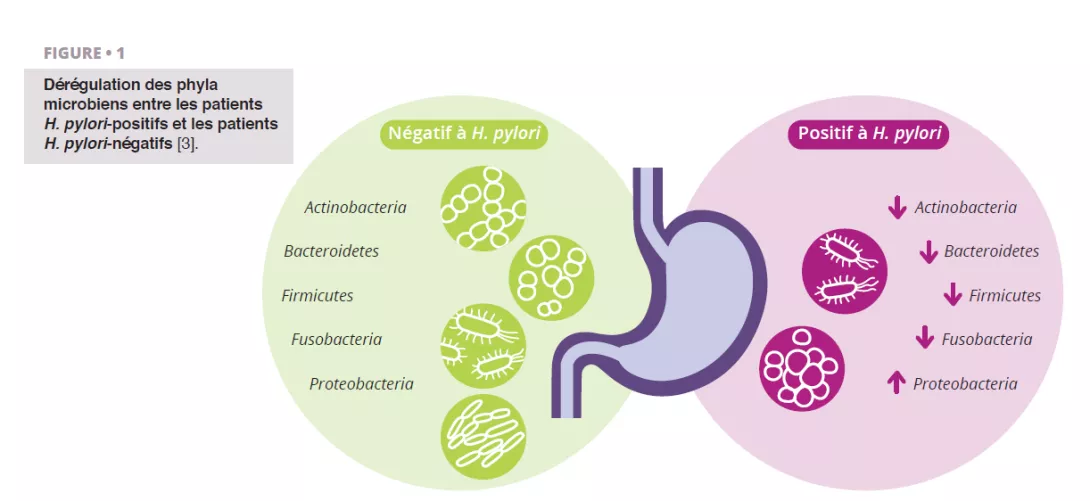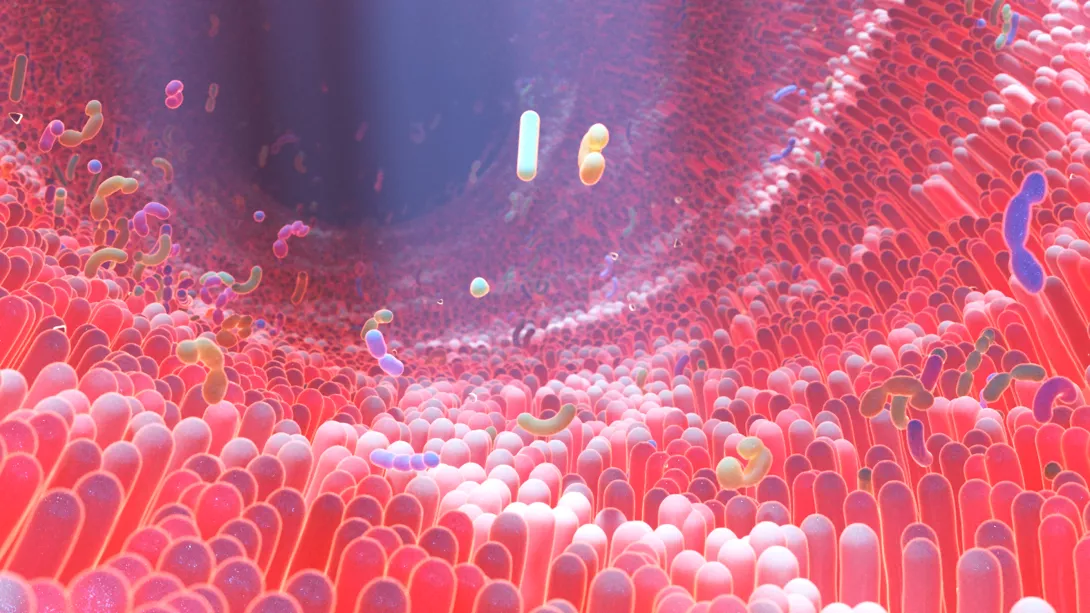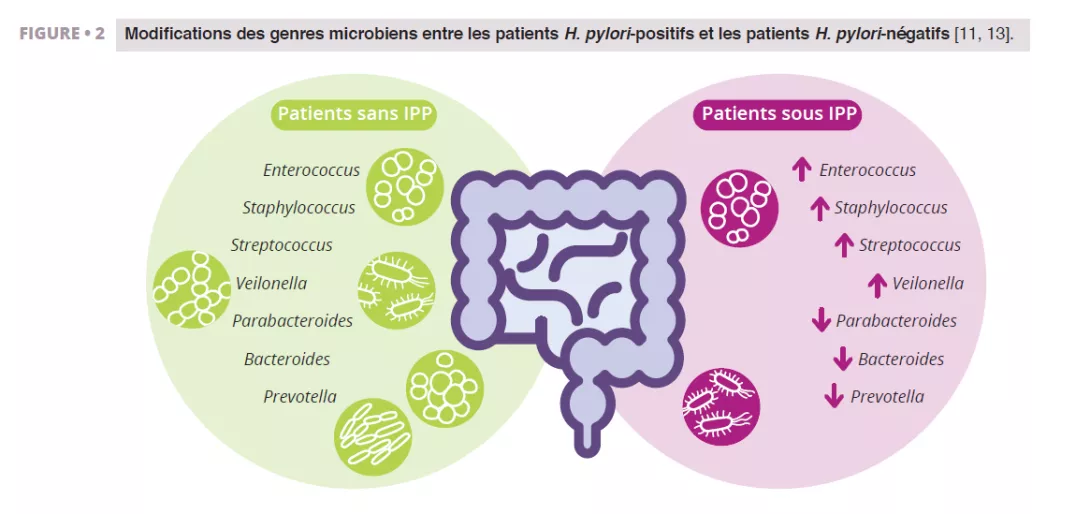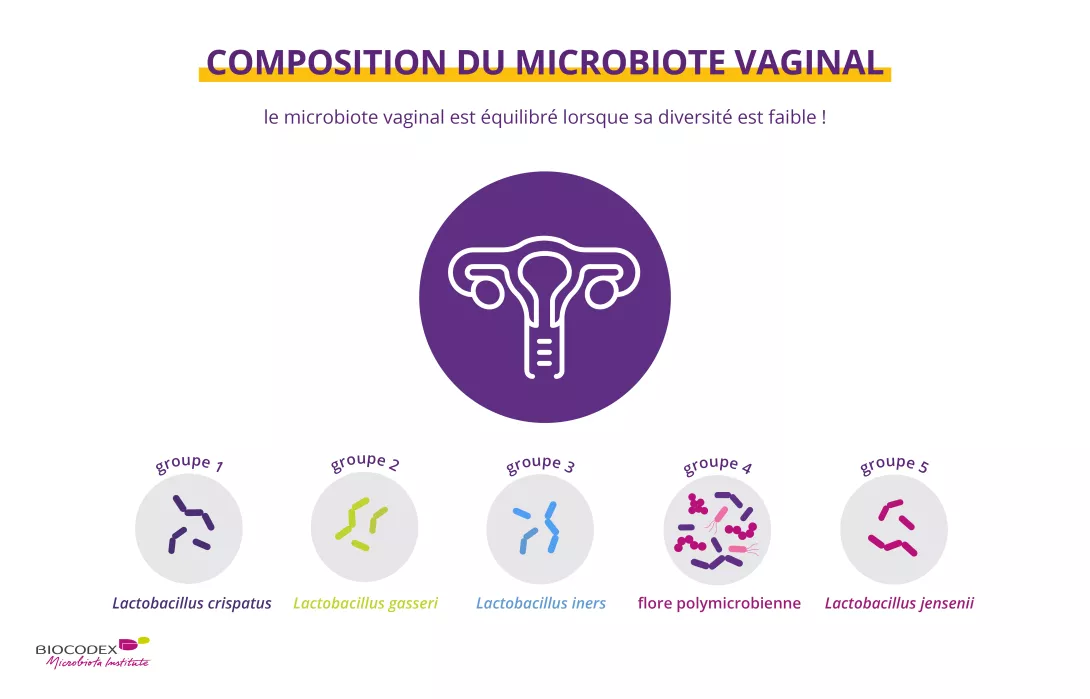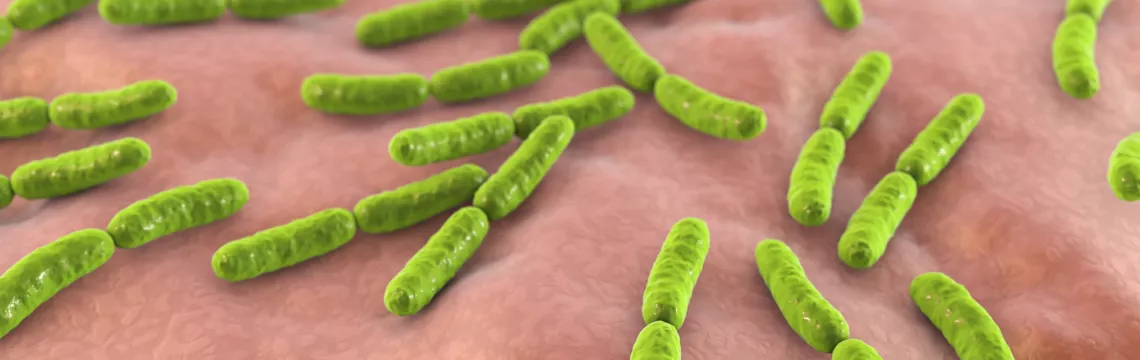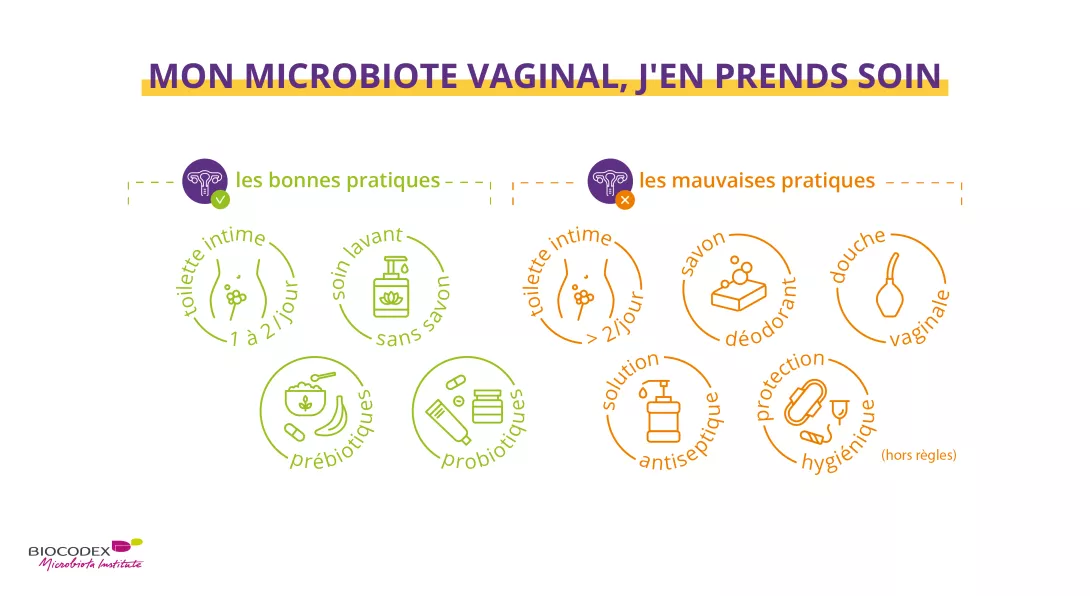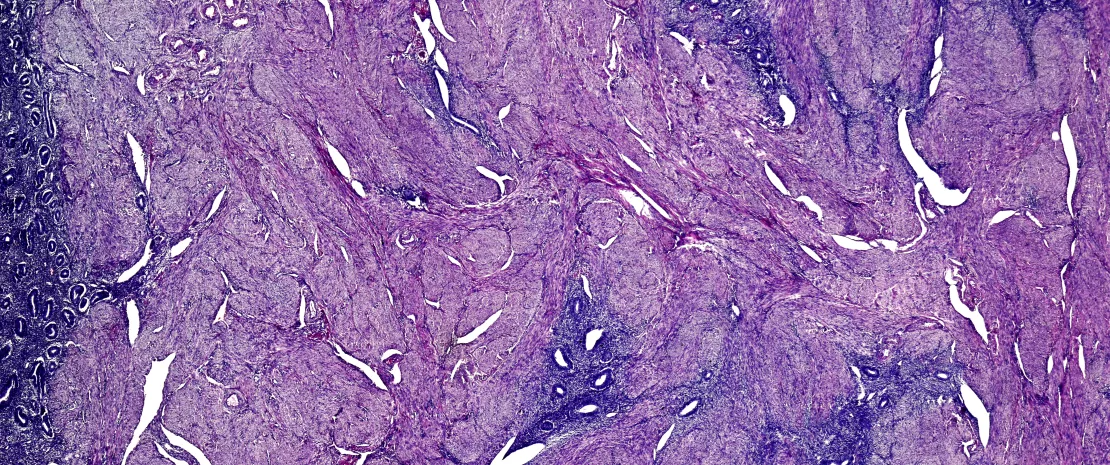Temps forts du congrès DDW
Par le Dr. Purna C. kashyap
Division de gastro-entérologie et d’hépatologie, Programme de microbiomique
Bernard et Edith Waterman, Centre de médecine personnalisée,
Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, États-Unis
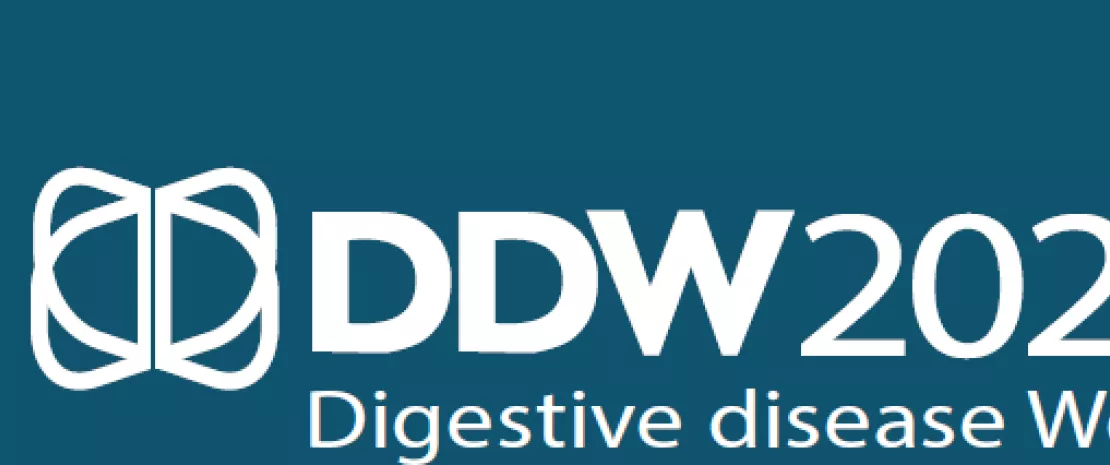
En mai 2024, plus de 13 000 professionnels intéressés par les maladies digestives et provenant de plus de 100 pays se sont rendus au congrès annuel « Digestive Disease Week » (DDW). Ce congrès, soutenu par l’Association américaine de gastro-entérologie (AGA), l’Association américaine pour l’étude des maladies hépatiques (AASLD), la Société américaine d’endoscopie gastro-intestinale (ASGE) et la Société américaine de chirurgie digestive (SSAT), a accueilli plus de 400 conférences originales et 4 300 sessions orales d’abstracts et de posters portant sur des innovations et travaux de recherche de pointe dans le domaine des maladies gastro-intestinales et hépatiques. La section dédiée au microbiote et à la thérapie microbienne et le centre d’éducation et de recherche sur le microbiote intestinal de l’AGA ont accueilli 11 sessions scientifiques avec 33 conférences proposées par des experts internationaux de premier plan ainsi que 52 présentations orales d’abstracts mettant en avant des travaux de recherche de pointe et des innovations dans le domaine du microbiote. Voici un résumé de quelques-unes des principales présentations.
Microbiote et cancer
La conférence inaugurale « Gail Hecht and David Hecht Distinguished Microbiome Lecture » a été donnée par la Dr Jennifer Wargo. Elle a présenté des données sur le micro-environnement tumoral, le microbiote intestinal dans le cancer, les biomarqueurs microbiens de la réponse au traitement ainsi que les nouvelles stratégies ciblant le microbiote tissulaire, tumoral et intestinal en vue d’intercepter et de prévenir le cancer. La Dr Wargo a résumé les découvertes montrant que la diversité et la composition du microbiote intestinal et tumoral sont des marqueurs pronostiques cruciaux pour l’évolution du cancer, en particulier après une greffe de cellules souches et chez les patients sous immunothérapie.

Probiotiques
La Dr Wargo a présenté des données suggérant que certains probiotiques pourraient aggraver l’évolution du cancer chez un sous-groupe de patients, une observation qui a également été faite dans des modèles animaux 1 (Spencer et al., Science, 2021). Cependant, un produit bactérien vivant, le CBM588, associé à un blocage de CTLA-4 et de PD-1, a montré des bénéfices dans le traitement du carcinome à cellules rénales métastatique 2. De plus, des bactéries commensales telles que Bifidobacterium ont démontré qu’elles stimulent l’immunité antitumorale et améliorent l’efficacité de traitements tels que les inhibiteurs de PD-L1 et de CTLA- 4, montrant le besoin d’approches probiotiques personnalisées et ciblées.
Antibiotiques
Comme avec les probiotiques, des patients ayant reçu des antibiotiques avant un traitement par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ont connu une évolution moins favorable 3. À l’inverse, des approches antibiotiques ciblées, notamment celles utilisant la ciprofloxacine ou le métronidazole pour cibler les bactéries intratumorales qui interviennent dans la résistance au traitement anticancéreux 4, 5, pourraient améliorer l’immunité antitumorale et les réponses au traitement.

Transplantation de microbiote fécal (TMF)
La TMF apparaît comme une approche prometteuse dans le traitement du cancer. De petits essais cliniques en ouvert ont montré que la TMF peut contrer la résistance à l’immunothérapie chez les patients atteints d’un mélanome métastatique 6, 7. La TMF de donneurs sains, combinée à un traitement anti-PD-1 chez des patients atteints de mélanome métastatique et naïfs de traitement, a été associée à des taux de réponse élevés.
Alimentation et microbiote
L’alimentation joue un rôle crucial pour moduler le microbiote intestinal et influer sur les résultats du traitement anticancéreux. Les patients consommant plus de 20 grammes de fibres par jour ont obtenu de meilleurs résultats avec leur traitement de blocage des points de contrôle immunitaire 1. Des études en cours utilisant des régimes riches en fibres et d’autres stratégies alimentaires personnalisées s’annoncent prometteuses pour améliorer les réponses au traitement anticancéreux.

Prébiotiques
La Dr Wargo a partagé des résultats encourageants d’interventions telles que le régime enrichi en aliments prébiotiques (prebiotic food-enriched diet, PreFED) et les sources alimentaires prébiotiques comme les haricots dans l’essai BEGONE, qui montrent comment les prébiotiques peuvent moduler les micro-organismes intestinaux et réduire l’inflammation systémique. De plus, la Dr Tessa Anderman a parlé des enseignements tirés d’un essai sur les prébiotiques conduit chez des patients bénéficiant d’une greffe allogénique de cellules hématopoïétiques (allogreffe). L’efficacité des prébiotiques et la production d’acides gras à chaîne courte varient selon le prébiotique utilisé et la composition du microbiote du patient, suggérant qu’une combinaison de différents prébiotiques pourrait être plus bénéfique.
Thérapies basées sur le microbiote
La Dr Colleen Kelly a exposé les grandes lignes des recommandations de pratique clinique de l’AGA concernant les thérapies basées sur le microbiote fécal dans les maladies gastro-intestinales. Chez les adultes immunocompétents, l’AGA suggère d’utiliser des thérapies basées sur le microbiote fécal après l’antibiothérapie standard, mais également chez les adultes légèrement ou modérément immunodéprimés atteints d’infections récurrentes à C. difficile ou chez les adultes hospitalisés avec une infection à C. difficile sévère ou fulminante ne répondant pas au traitement standard. Par ailleurs, l’AGA suggère d’utiliser une transplantation de microbiote fécal conventionnelle après l’antibiothérapie standard. Chez les adultes atteints d’une rectocolite hémorragique, d’une maladie de Crohn, d’une pouchite ou d’un syndrome de l’intestin irritable, l’AGA déconseille l’utilisation de la transplantation de microbiote fécal conventionnelle, sauf dans le cadre des essais cliniques. La Dr Jessica Allegretti a fait un tour d’horizon de l’état actuel des thérapies basées sur le microbiote fécal, évoquant les dernières recommandations de la FDA indiquant qu’une demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental est nécessaire lors de l’utilisation de produits à base de selles provenant de biobanques, de même qu’une sélection plus poussée des donneurs avec notamment une recherche du Sars- Cov-2 et de bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) du fait du signalement d’infections systémiques par des bactéries productrices de BLSE après une TMF chez deux patients immunodéprimés. L’arsenal thérapeutique pour les infections à C. difficile évolue rapidement, avec l’autorisation par la FDA de deux nouveaux produits à base de microbiote fécal pour la prévention des ICD récidivantes, à savoir REBYOTA (microbiote fécal vivant – jslm) en administration rectale unique et VOWST (spores microbiennes fécales vivantes - brpk) à raison de 4 gélules par voie orale une fois par jour pendant 3 jours consécutifs, 3-4 jours après l’antibiothérapie standard, et un essai de phase III en cours sur des consortiums bactériens vivants définis de manière rationnelle, non issus de selles de donneurs.
Un débat modéré sur le rôle des probiotiques dans les maladies GI a permis de faire une revue complète de l’utilisation des probiotiques chez les adultes et les enfants. La discussion s’est concentrée sur la marche à suivre, et si les probiotiques semblent manquer d’efficacité dans les troubles gastro-intestinaux de l’adulte lorsque l’on considère la littérature dans son ensemble, leurs effets varient selon les espèces et les souches et certains patients pourraient en tirer un bénéfice. De plus, les produits fermentés faits maison comme le yaourt, le kimchi et le kéfir ont été abordés à titre d’alternatives offrant un bon rapport coût/efficacité. Les différences observées au niveau des recommandations émises par les différentes sociétés savantes concernant l’usage des probiotiques semblent dues aux différences d’ordre méthodologique et de nature entre les études cliniques sur lesquelles s’appuient ces recommandations. Les autotests du microbiote gagnent en popularité auprès des patients, notamment pour guider le traitement probiotique, mais le panel a conclu qu’il n’y a actuellement aucun bénéfice clinique prouvé et qu’ils ne doivent donc pas être recommandés. Néanmoins, il existe un potentiel d’utilisation future, notamment pour le suivi des modifications du microbiote chez un patient après une intervention. Toutes ces discussions ont fait émerger un thème central : le besoin d’adopter des approches personnalisées pour les thérapies basées sur le microbiote.