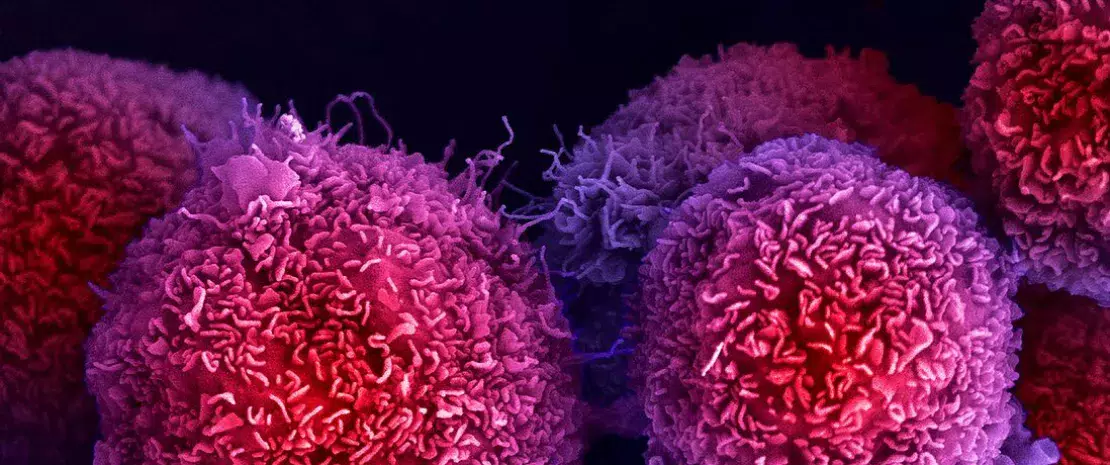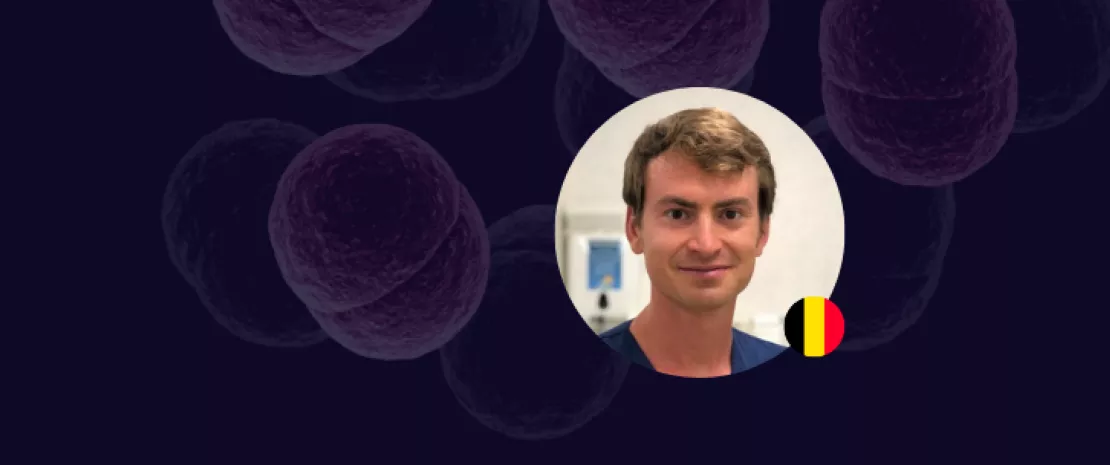Vous voulez en savoir plus sur le Dr. Wauters
À votre avis, quelle est la principale avancée scientifique de ces dernières années en lien avec le microbiote ?
Une meilleure caractérisation du microbiote intestinal en bonne santé, par exemple, les effets de la consistance des selles et le profilage quantitatif du microbiote (Vandeputte et al., Gut 2016 et Nature 2017) afin de définir les altérations du microbiote ayant vraiment un lien avec la maladie (et ne se limitant pas, par exemple, à des différences de temps de transit).
Pensez-vous que l’on assiste récemment à un regain d’intérêt pour le microbiote ?
Oui, mais il faudrait davantage de normalisation pour pouvoir comparer les résultats de différentes études.
Quel conseil pourriez-vous nous donner pour prendre soin de notre microbiote ?
Nourrir son intestin en consommant des aliments végétaux contenant des prébiotiques naturels.
Pourriez-vous nous raconter une anecdote ou une histoire surprenante en rapport avec vos recherches?
Les échantillons de selles n’apportent pas d’informations détaillées sur le microbiote de l’intestin grêle, pour lequel les techniques optimales de prise d’échantillons sont encore à l’étude.
Quelle est selon vous la bactérie la plus fascinante ?
Lactobacillus, en raison de sa grande capacité de fermentation.
Avez-vous à l’esprit une personne qui serait une source d’inspiration pour vous ? (dans le domaine de la recherche ? / en médecine ? / en général ?)
Andreas Vesalius, pour sa remise en question courageuse des dogmes et pour les recherches originales qu’il mène à Louvain.