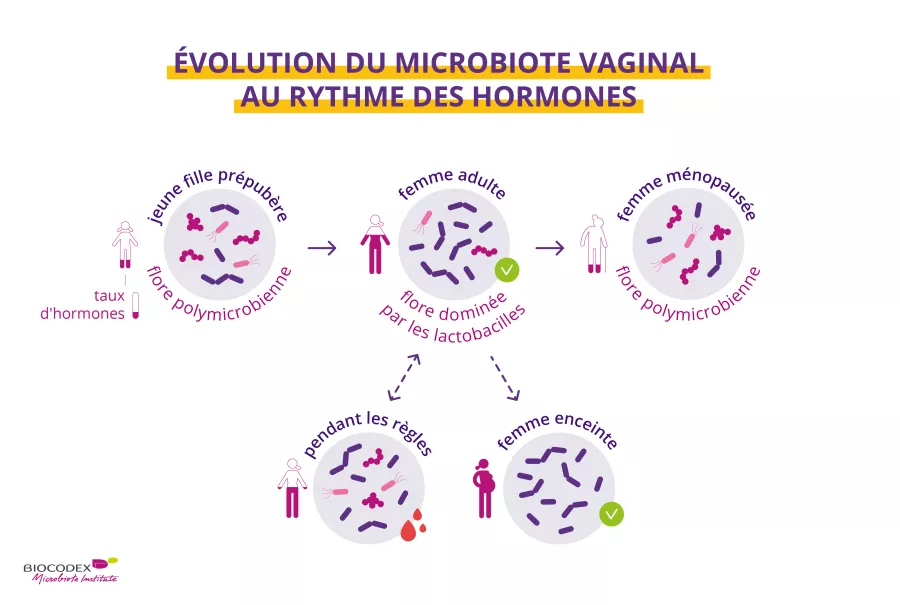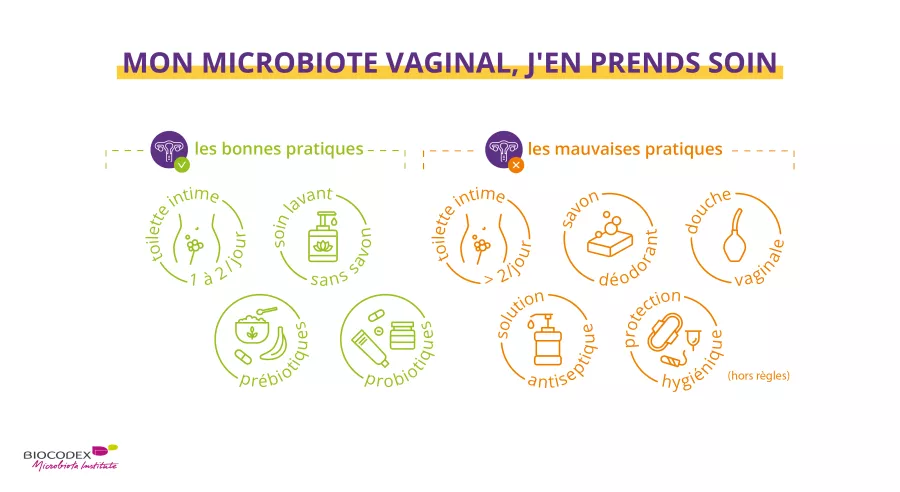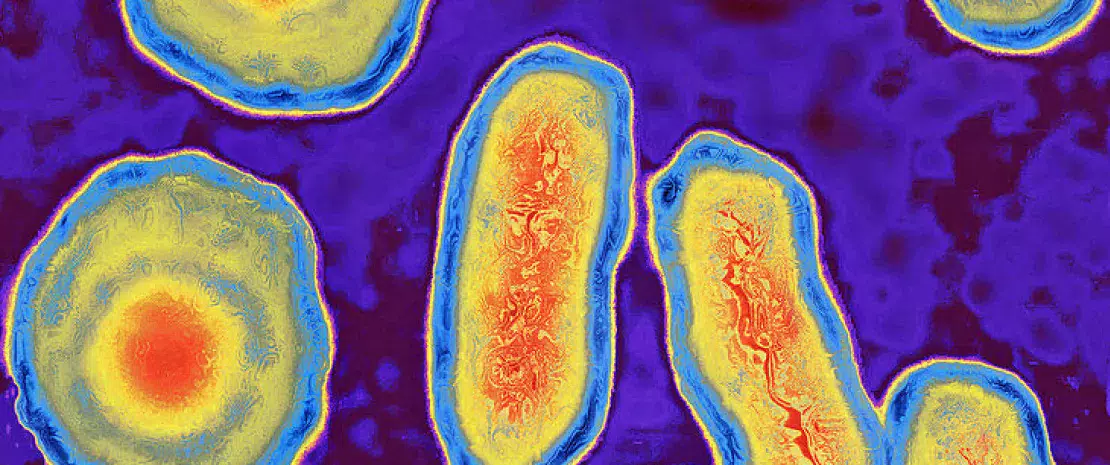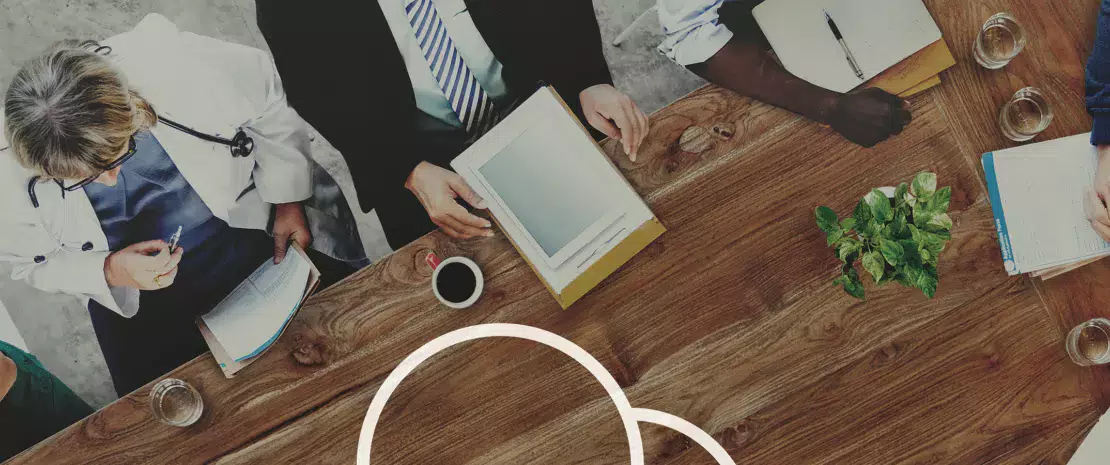Que pensez-vous des hypothèses des chercheurs suggérant que l’exposition aux microplastiques pourrait être liée à la pathogénie des MICI ou que les MICI exacerbent la rétention des MP ?
Près de 71 % des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) pensent que l’alimentation influence leurs symptômes et 81 % suivent des régimes d’éviction alimentaire lors des phases de rémission. Toutefois, les recommandations alimentaires actuelles sont confuses et contradictoires. Dans cette étude, dirigée par le Dr Yan Zhang, les auteurs ont émis l’hypothèse que les microplastiques (MP) pourraient contribuer au développement des MICI. Les MP sont de petites particules de plastique (diamètre < 5 mm) et sont considérés comme un problème environnemental majeur compte tenu de la surconsommation actuelle de plastiques. Les MP sont largement distribués, facilement ingérés à notre alimentation, voire inhalés, et ils pourraient s’accumuler dans divers organes du fait de leur petite taille et de leur faible taux de dégradation. Même si les études précliniques ont évoqué les effets néfastes des MP sous forme de troubles du métabolisme et d’inflammation, leur impact sur la santé humaine n’a pas encore été entièrement élucidé. Dans cette étude, les auteurs ont recueilli les fèces de volontaires sains et de patients atteints de MICI et ont analysé la concentration de MP. Les auteurs ont montré une concentration de MP fécaux plus élevée chez les patients atteints de MICI que chez les volontaires sains. Il est intéressant de noter que la concentration de MP a montré une corrélation positive avec la sévérité de la maladie, suggérant que les MP pourraient être des facteurs déclenchants de l’activation clinique dans les MICI tout en évoquant un lien possible entre l’alimentation et l’inflammation. De fait, les auteurs ont rapporté que les patients qui avaient une quantité plus importante de MP fécaux consommaient davantage de produits conditionnés en emballages plastiques. Même s’il a été suggéré que les MP pourraient traverser la barrière intestinale pour se retrouver dans la circulation sanguine et avoir un impact potentiel sur la santé, les résultats ne sont que préliminaires et davantage d’informations sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions concernant les patients. Indépendamment de l’impact des MP sur le tube digestif, cette étude alerte sur les inquiétudes mondiales concernant l’utilisation actuelle importante de plastiques, sur les implications qu’elle pourrait avoir pour la santé humaine au travers de la chaîne alimentaire mais aussi des matières premières et des produits agricoles et sur la nécessité urgente de réduire l’usage des plastiques.
Que conseilleriez-vous aux patients souffrant de MICI concernant l’exposition aux microplastiques ?
Les résultats doivent être pris avec précaution, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’augmentation rapportée des MP fécaux dans les MICI et les implications en termes de sévérité clinique. Même si la consommation alimentaire semble être l’hypothèse la plus plausible, de nombreux facteurs démographiques, méthodologiques ou cliniques pourraient expliquer cette augmentation. Il serait intéressant de voir si ces observations s’appliquent à d’autres pays que la Chine, où les MICI sont en augmentation. Les patients atteints de MICI présentent également une altération du microbiome intestinal, de l’absorption, de la perméabilité et de la motricité intestinales ainsi qu’une consistance des selles différente, des facteurs qui peuvent tous influencer l’excrétion des MP. En effet, le microbiome intestinal est un écosystème complexe et divers comprenant des microbes capables de digérer différents composants, y compris les MP, et les patients atteints de MICI présentent une altération du microbiome. De plus, les patients consomment fréquemment différents médicaments ou bioproduits (vitamines, probiotiques, etc.) pour traiter leurs symptômes et cela pourrait également avoir un impact indirect sur les MP fécaux. Enfin, l’alimentation influence la symptomatologie des MICI ; or il existe une fausse idée reçue selon laquelle les aliments ultra-propres, qui sont souvent conditionnés en emballages plastiques ou en bouteilles (voir la consommation accrue d’eau en bouteille ces dernières décennies), sont bénéfiques. Les choix alimentaires des patients pourraient ainsi potentiellement inclure davantage d’aliments emballés sous plastique. Je conseillerais aux patients de suivre les régimes alimentaires traditionnels et bien tolérés, de privilégier les aliments faits maison et naturels et d’éviter les aliments à la fois ultra-transformés et conditionnés en emballages plastiques. La réduction du plastique est également bénéfique pour notre planète !

 L'avenir (du microbiote) appartient à ceux qui se lèvent tôt
L'avenir (du microbiote) appartient à ceux qui se lèvent tôt