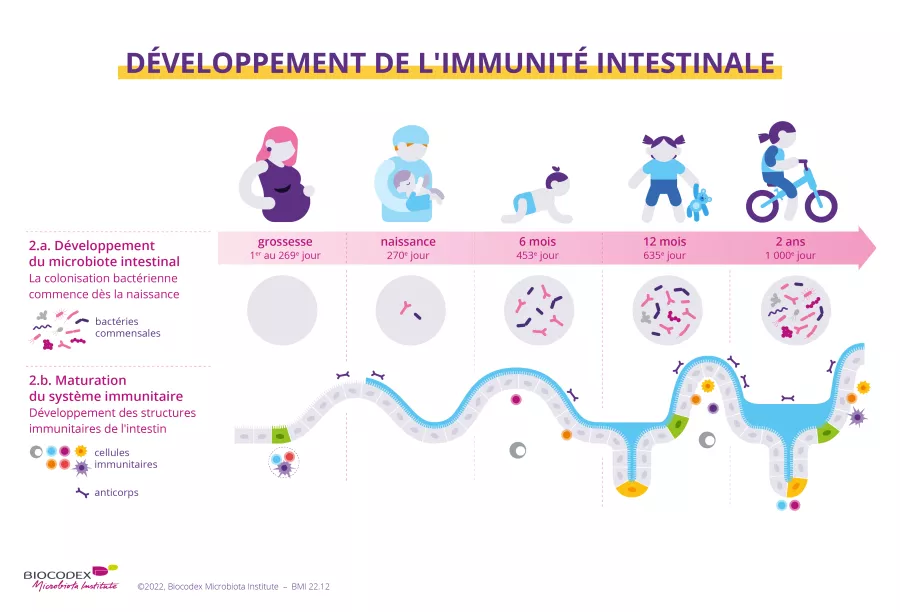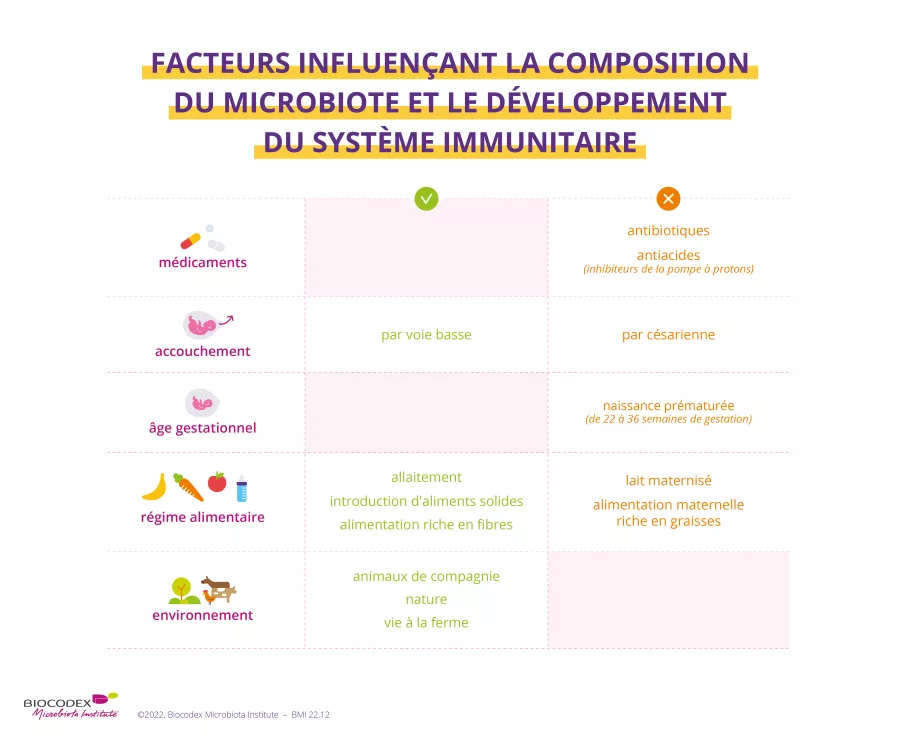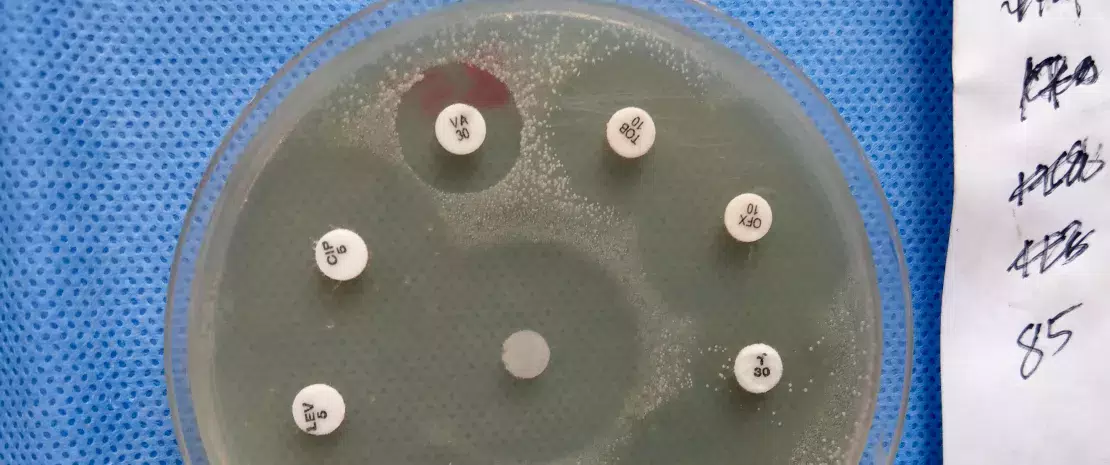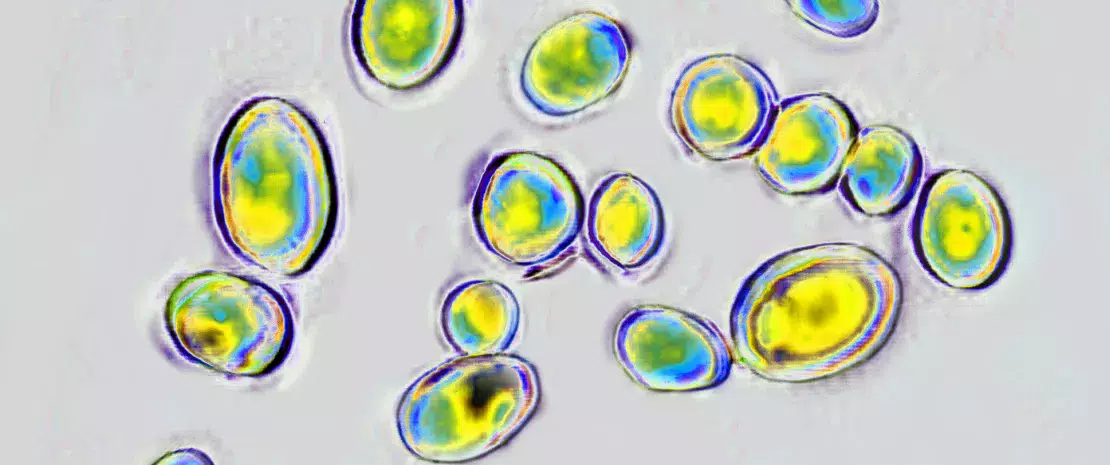Le French Gut s’inscrit dans un vaste projet international, le « Million Microbiome of Humans Project » (MMHP) qui réunit plusieurs instituts de recherche à travers le monde. Le MMHP nourrit une ambition forte : constituer la plus grande base mondiale de données sur les microbiotes humains, en collectant un million d’échantillons microbiens provenant des intestins, de la bouche, de la peau ou de l’appareil reproducteur de sujets volontaires. Le French Gut, porté par INRAE en partenariat avec des acteurs publics et privés impliqués dans le domaine du microbiote, contribuera significativement à l’élaboration de cette base de données internationale par la collecte de 100 000 métagénomes intestinaux français.
Le French Gut peut compter sur le solide soutien du Biocodex Microbiota Institute. Les objectifs de ce projet consistent à recruter 100 000 participants, sensibiliser le grand public dont les professionnels de santé sur les pouvoirs fascinants du microbiote intestinal, notamment son rôle dans la survenue d'un certain nombre de pathologies.
Un objectif partagé : mettre en lumière l’importance des effets du microbiote intestinal sur notre santé
Le Biocodex Microbiota Institute partage la même ambition que Le French Gut : sensibiliser le grand public et former les professionnels de santé à l’importance majeure du microbiote notamment à l’impact d’une dysbiose sur notre santé. Depuis 2017, le Biocodex Microbiota Institute :
Contacts :
Biocodex Microbiota Institute
Olivier VALCKE,
Responsable Editorial & Relation Presse
Tél. : +33 06 43 61 32 58
o.valcke@biocodex.com
Le French Gut
frenchgut-presse@inrae.fr
presse@inrae.fr
BMI 22.46

 Un régime méditerranéen, bon pour le corps, bon pour le cœur
Un régime méditerranéen, bon pour le corps, bon pour le cœur