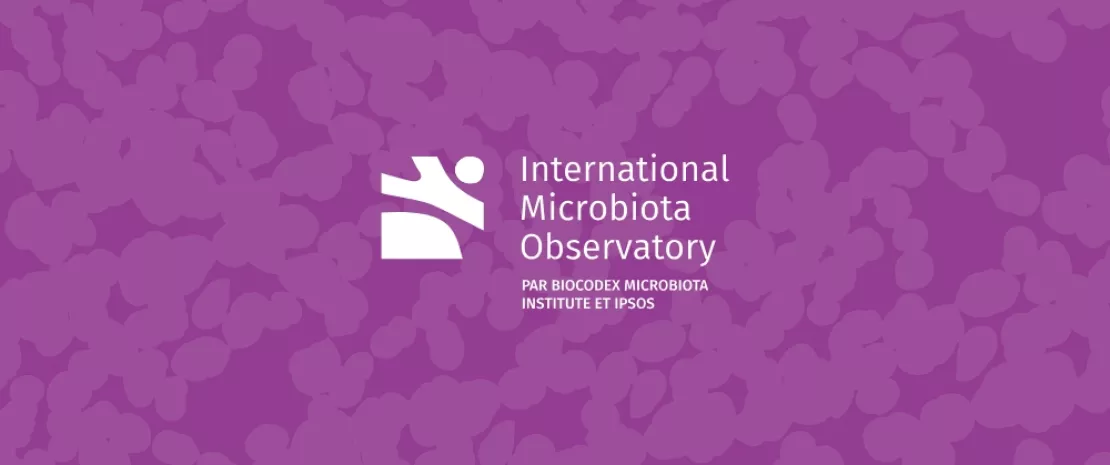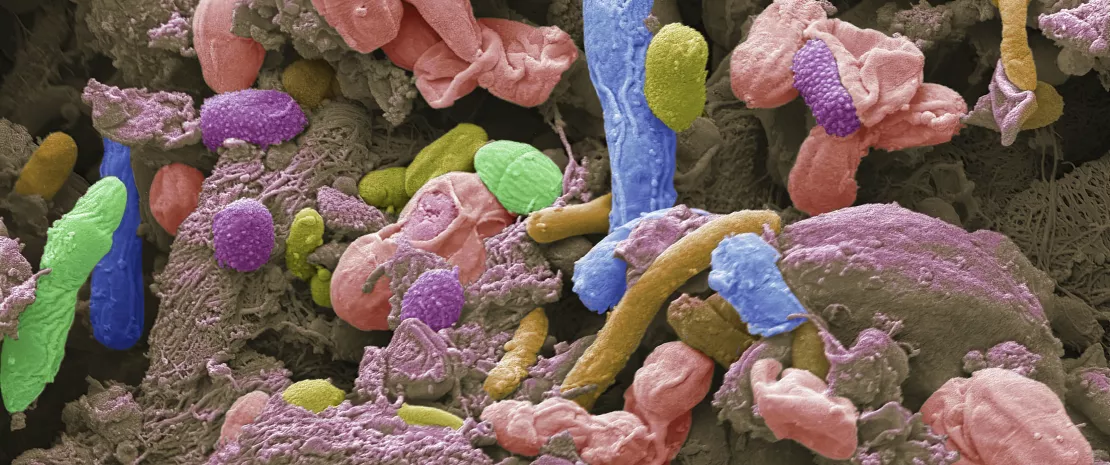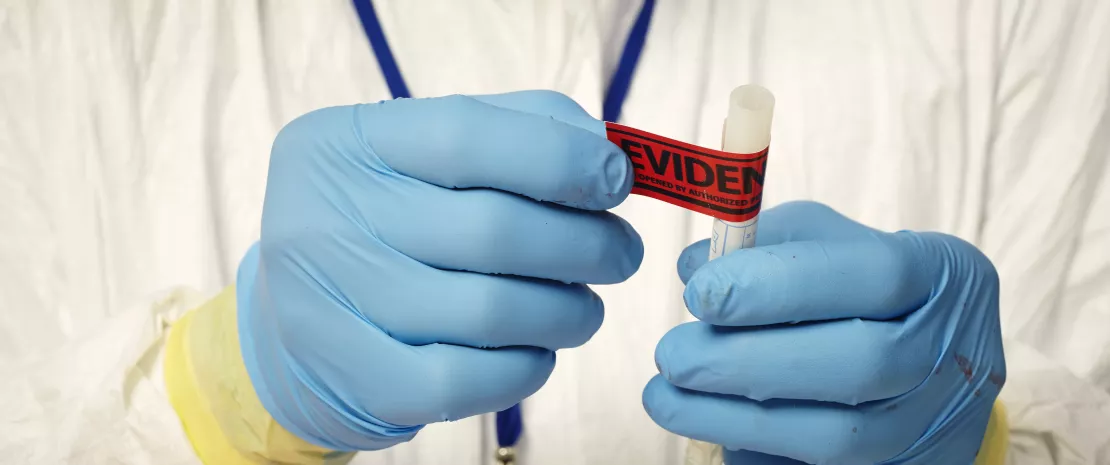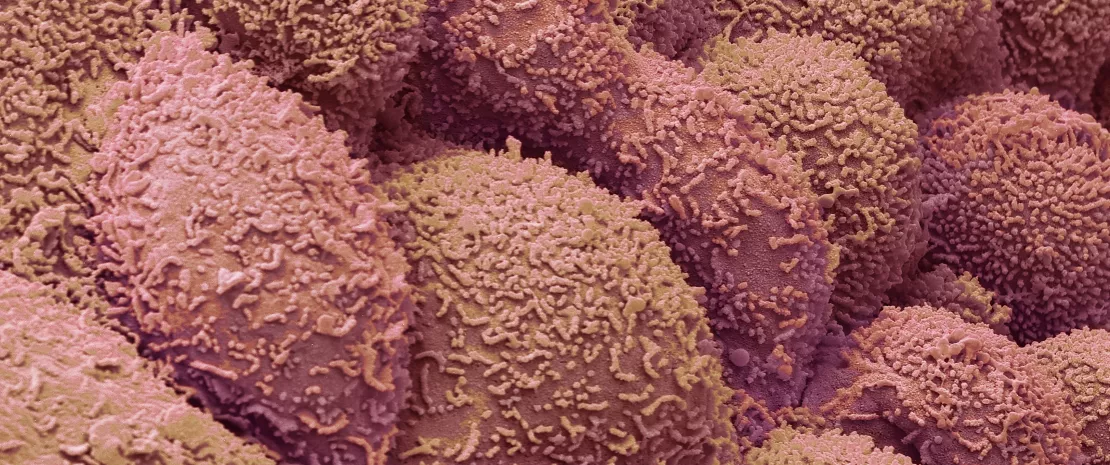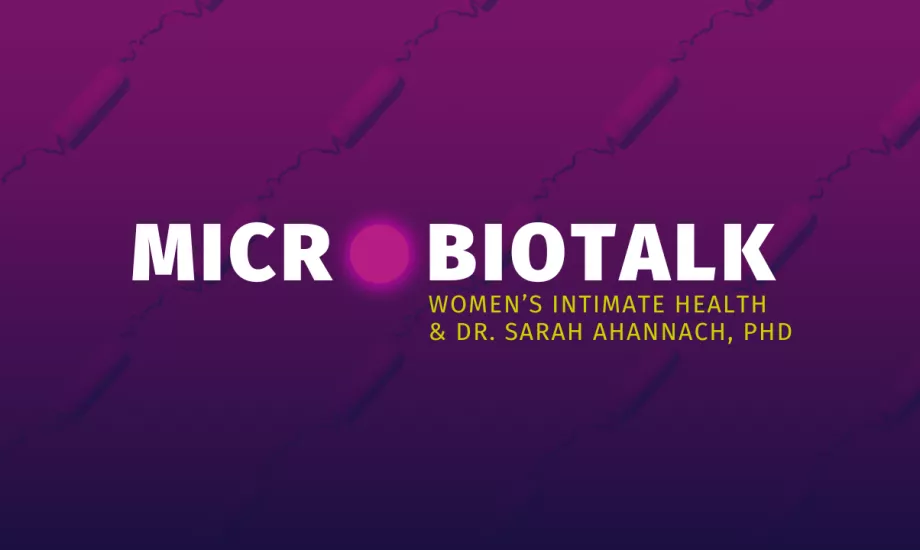Nous avons reçu de très nombreuses questions. Je vais en prendre quelques-unes. La première est pour Florence.
Depuis que vous avez commencé votre travail, avez-vous observé des progrès ou au contraire un retour en arrière concernant les sujets liés au vagin ou à la santé génitale féminine ?
Oh, c’est une question intéressante. À travers mon travail au musée du vagin, on a vraiment vu une évolution positive dans la manière dont les gens parlent de l’anatomie gynécologique. Je pourrais vous donner plein d’exemples de moments où j’ai changé l’avis des gens et amélioré leur quotidien.
Mais, à une échelle plus large, on observe aussi une chose : le monde devient de plus en plus polarisé — et les données le confirment. Et les droits des femmes font évidemment partie de cette dynamique. Ce n’est pas juste une question politique : il y a aujourd’hui davantage de honte, notamment sur Internet, où les femmes sont critiquées pour leur manière de s’habiller, leur apparence, etc.
Mais d’un autre côté, on observe aussi une grande vague de soutien. Donc... difficile de trancher. Dans certains domaines, oui, on progresse. Dans d’autres, non.
Merci Florence. Une question pour Sarah maintenant. Vous avez mentionné la « sororité Isala » et des projets « filles » comme le projet Nuna. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. En fait, on reçoit aussi des questions via Instagram ou les réseaux sociaux. Des femmes nous disent : “Je porte tel type de sous-vêtements, quel est le meilleur tissu ?” Et nous, on se disait : “Bonne question… mais on n’a pas vraiment de réponse.” Et en même temps, on ne veut pas créer une société où la gynéco vous donne une liste de tout ce que vous devez faire pour être parfaite... et où malgré tout, certaines auront des infections — parce que parfois, c’est juste lié à la génétique ou au système immunitaire.
Alors on a lancé une étude, et on s’est dit que ce n’était pas seulement une question de culotte, mais aussi de produits d’hygiène menstruelle. Tous les mois, on les utilise, et ils n’ont jamais été étudiés en lien avec le microbiote. Récemment, on a parlé de la présence de produits chimiques ou toxiques, mais pas vraiment de leur impact sur la santé.
Donc on a lancé le projet Luna. Il implique 100 femmes, certaines sous pilule, d’autres non. Chaque mois, elles utilisent un produit menstruel différent : tampon, serviette, cup, et deux types de culottes menstruelles (coton et synthétique). Elles nous envoient ensuite des échantillons que nous analysons.
On mène des études similaires au Pérou et au Cameroun. On espère pouvoir comparer les données. D’ailleurs, dès l’étude Isala initiale, on avait vu que les serviettes hygiéniques étaient associées à un microbiote plus diversifié. Donc on voulait creuser plus loin : est-ce dû au produit lui-même ? À la manière dont il est porté ? C’est ce qu’on explore.
Merci Sarah. Une question pour Alessandra : Comment ouvrir la parole des femmes pendant une consultation médicale ?
- Si vous n’avez pas les récepteurs… il n’y aura pas de dialogue. D’abord, il faut être formé à prendre une anamnèse complète.
- Ensuite, il faut écouter attentivement la douleur, car elle est souvent le symptôme principal.
- Et enfin, il faut actualiser ses connaissances sur la physiopathologie. Car la douleur n’est que la partie visible de l’iceberg.
En tant que médecin, je dois comprendre les mécanismes qui entretiennent cette douleur. Si je ne les connais pas, il n’y a pas de conversation possible. C’est pourquoi je suis si critique sur le niveau de formation actuel. Nous lisons tous des publications, mais aux États-Unis, une étude a montré qu’un interne passait 1h30 auprès des patients… et 5h30 sur son ordinateur. Alors je vous pose la question : soigne-t-on des patients, ou soigne-t-on des documents ?
Si on ne remet pas le corps au centre comme le protagoniste principal, je ne vois pas d’avenir très brillant. Il y a beaucoup d’idéologie, et on perd l’essence même de la médecine. Il y a beaucoup à changer. Mais nous sommes engagés. Et ensemble, avec des regards différents mais un objectif commun, on peut améliorer les choses.
Merci Alessandra. Question pour Florence. Comment éduquer les jeunes générations à la santé intime ?
Très grande question. Il y a plusieurs manières.
- L’école, évidemment. Mais je pense qu’on se concentre trop sur l’école seule.
- L’éducation doit aussi se faire à la maison. Les parents doivent se sentir à l’aise pour expliquer ces choses. Beaucoup de visiteurs du musée me disent : “J’ai un enfant en bas âge, je veux lui parler de son corps, mais je ne sais pas comment appeler les parties intimes, je me sens mal à l’aise.” Et je leur dis : “Même s’il a trois ans, dites-lui le mot juste : vulve. Ce n’est pas bizarre. C’est mieux que de dire 'foufoune', 'minou', ou 'petit devant'.” Ces euphémismes transmettent l’idée que c’est une partie honteuse qu’il faut cacher.
- On peut aussi agir via la culture sur la jeune génération et normaliser la discussion. En Suède, il existe un dessin animé très mignon, qui s'appelle, excusez-moi par avance pour mon suédois, “Snoppen och Snippan” — un petit pénis et une petite vulve qui parlent pour expliquer leur rôle aux enfants.
Bref, il faut que ça passe par tous les canaux de la société, pas juste un. Merci Florence.
Vous souhaitez ajouter un mot ?
Alessandra: Juste pour insister sur un point : beaucoup de femmes continuent de nommer le vagin, la vulve. Elle disent, aussi : “mon vagin est sec” alors qu’elles parlent de la vulve.
C’est pour ça que je recommande que tous les médecins aient une image anatomique sur leur bureau, pour qu’on puisse désigner : “Où avez-vous mal ? Où ça brûle ?”
Par exemple, l’hymen marque la limite entre la vulve et le vagin. Et le vestibule est une zone très riche en fibres sensitives : ça peut donner beaucoup de plaisir si tout va bien… mais aussi beaucoup de douleur si quelque chose va mal. Et le microbiote a un rôle énorme à cet endroit.
Même les femmes adultes devraient savoir que le vagin est le canal à l’intérieur, et la vulve, l’extérieur. Si elles n’utilisent pas les bons mots, on risque de se tromper sur la localisation du symptôme. Et si le médecin n’est pas rigoureux, sans schéma, il passe à côté. Donc l’éducation sur l'anatomie des femmes est fondamental.
Question pour Sarah : Combien de personnes participent au projet ISALA dans son ensemble ?
Oh… Je pense qu’en Belgique, actuellement, nous avons environ 10 000 participantes. Et à l’échelle mondiale, je n’ai pas le chiffre exact, parce que nous recevons des échantillons tous les jours. Par exemple, demain, des échantillons vont arriver du Cameroun, et une chercheuse vient avec eux. Donc oui, ça grandit, ça évolue. Notre objectif, c’est vraiment de créer une sorte d’atlas mondial du microbiote vaginal.
— C’est immense. Vraiment immense. Merci.
Alessandra : Que peut-on mettre en place pour prévenir les douleurs menstruelles ?
Grande question. Pourquoi les femmes ont-elles des douleurs menstruelles ? Pourquoi certaines, et pas d’autres ? Quels sont les facteurs prédictifs ? Nous avons une énorme étude menée au Royaume-Uni sur 5 500 femmes atteintes d’endométriose et plus de 22 000 femmes témoins. Ce qu’elle montre, c’est que…
Si une femme souffre de règles abondantes, la probabilité de développer une endométriose est multipliée par 5 par rapport à une femme avec des règles normales.
Mais, ce qui est important : les femmes ayant des règles abondantes deviennent anémiques, elles souffrent d’anémie par carence en fer, ce qui double le risque de dépression et double le risque de baisse de libido. Et pourtant, aucun sexologue ne pose de questions sur les règles ni ne vérifie s’il y a une anémie.
Tout le monde passe des heures chez le psy, alors qu’en réalité, c’est peut-être juste du fer qu’il faut. Ensuite : si une femme a des douleurs pendant les rapports sexuels, ses chances d’avoir une endométriose sont multipliées par 9,8. Et si elle a des douleurs pendant ses règles : encore 9,8. Et si vous cumulez ces trois éléments (douleurs pendant les règles, douleurs pendant les rapports, règles abondantes), le risque est multiplié par 22,9. C’est énorme. Ça veut dire, clairement, qu’il y a quelque chose de sérieux. Alors que faire ? D’abord, une anamnèse très précise, très rigoureuse. On vérifie tout : son profil hormonal, etc. Ensuite, on prescrit un progestatif, une pilule, un patch, peu importe, quelque chose qui permet de stabiliser le niveau d’œstrogènes. Pourquoi ? Parce que lorsque les œstrogènes fluctuent, ils déclenchent une inflammation. Mais lorsqu’ils sont stables, ils réduisent l’inflammation. Et ça, c’est un point clé dans l’infertilité. C’est encore mal compris, parce que beaucoup — chercheurs comme médecins — ne font pas la différence entre “fluctuation” et “niveau constant”.
Rappelez-vous : il y a 100 ans, et depuis 200 000 ans, les femmes avaient, au maximum, comme je le dis souvent, 140 à 150 règles au total sur toute leur vie fertile. Souvent moins de 100. Pourquoi ? Parce que la puberté arrivait plus tard, les femmes avaient plusieurs enfants, elles allaitaient pendant deux ans… et, soit dit en passant, elles mouraient plus tôt. Aujourd’hui, nous avons triplé le nombre de menstruations. Cela représente 13 règles par an. Et si une femme a mal à chaque fois, ça fait 13 pics d’“inflammation immunitaire” par an. Et si elle a des règles abondantes, le sang peut refluer dans le bassin, se répandre… et entraîner une endométriose. On ne peut pas minimiser les règles abondantes. 20 % des femmes en souffrent. Une sur cinq. Oui. Donc voilà. Je voulais vous donner ces chiffres, parce que ce sont les preuves dont on a besoin. Mais ensuite, il faut revenir à la physiopathologie, et changer le destin. Voilà.
Très bien. Merci. Merci Alessandra.
Question pour toutes les intervenantes : Nous parlons de santé des femmes… mais alors, comment impliquer davantage les hommes ?
Florence : Eh bien… au Musée du Vagin, certaines personnes nous demandent parfois : "Les hommes peuvent-ils visiter ?". Et je leur réponds : "Mais bien sûr ! Évidemment."
Les seuls à m’avoir dit un jour "Je ne suis pas sûr de venir"… ce sont des hommes gays. Mais même eux, en fin de compte, ils adorent et ils viennent, souvent avec leurs amis, leurs sœurs, leurs mères. Tout le monde comprend qu’il est important de s’informer. On voit souvent des pères célibataires venir avec leurs filles, parce qu’ils se disent : "Je vais devoir lui parler de la puberté, et je ne sais pas comment faire, parce que moi, je n’ai jamais eu de règles." Et parfois, ce sont les médiateurs du musée ou les personnes à l’accueil qui les aident à trouver les bons mots. Donc oui, nous avons des visiteurs hommes, de tous âges. Et je pense que l’un des éléments les plus importants, c’est simplement de leur dire : "Oui, vous avez le droit d’en parler. Vous avez le droit de poser des questions." Et dans ma vie perso, par exemple, si je vais aux toilettes pour changer ma serviette hygiénique, je ne la cache pas dans ma manche. Je la prends, je marche avec. Je me dis : "Je n’ai pas à avoir honte. Et toi, tu es gêné ? Pas moi." Merci. Voilà.
Sarah?
Je pense que ça commence très tôt, dès l’école. Si on aborde ces sujets très ouvertement, si tout le monde est impliqué dès le début, ça change tout. Parfois, même les garçons doivent faire un exposé sur le vagin ou le microbiote — et voilà, ça commence comme ça. Et puis il y a aussi la notion d’exposition : plus on est exposé à ces sujets, plus on les intègre. Je pense aussi que c’est à nous, les femmes, de ne pas enfermer tout ça dans un discours par des femmes, pour des femmes. Non, c’est pour tout le monde. C’est un sujet pertinent pour tous. Mais les hommes doivent aussi se former eux-mêmes. Ils sont assez grands pour ça.
Ce n’est pas juste une question de sexisme ou de racisme. C’est une question d’éducation. Tout le monde connaît une femme — et même si ce n’est pas le cas, c’est quand même un sujet pertinent.
Donc oui, pour moi, c’est une question de responsabilité et d’éducation. Mais je sens qu’il y a un vrai changement en ce moment. Dans notre équipe de recherche, il y a beaucoup de diversité. Et les gars disent des choses comme "J’étudie le vagin depuis huit ans." Donc c’est complètement normalisé. Finalement, je pense que c’est surtout une question de parler ouvertement du sujet.
Alessandra : Alors, plusieurs choses.
D’abord, historiquement, c’était les seins qui étaient mis en avant, pas les organes génitaux. Et aujourd’hui, on a un problème majeur : dans les manuels scolaires d’anatomie, les lèvres vulvaires sont représentées par deux fines lignes. Résultat : on voit une explosion des demandes de chirurgie des lèvres (labiaplastie), pour les rendre plus fines, plus discrètes. C’est un désastre médiatique et éditorial. Mais à côté de ça, il y a du positif. Quand je vois des maris, des pères, des fils accompagner une femme à une consultation, je découvre souvent le meilleur de la masculinité. Je n’aime pas cette polarisation où les femmes seraient parfaites et les hommes mauvais. Non. Il y a aussi des femmes bêtes, et des hommes intelligents. Et j’ai eu la chance de voir beaucoup d’hommes accompagnants, et quand je leur explique pourquoi elle a mal, pourquoi elle a mal pendant les rapports, et que je leur explique la biomécanique de la douleur, leur visage change. Parce que je parle comme un homme aimerait qu’on lui parle. Pas un truc du genre "Elle refuse de faire l’amour, elle ne veut plus de toi". Non. Il y a une raison mécanique. "La porte est fermée. Apprenons à l’ouvrir."
Et je leur dis : "Je peux vous apprendre — si elle est d’accord — à détendre le plancher pelvien, à intégrer ça dans les préliminaires." Et là, ils deviennent les meilleurs alliés. Donc travaillons ensemble. Ne polarisons pas les bons d’un côté, les méchants de l’autre. Il y a des gens de qualité des deux côtés. Et si on collabore, c’est ça mon message principal : on avance. Sinon, on perd de l’énergie dans des combats inutiles.
Florence: Je peux… ? Ah, pardon ! Est-ce que je peux partager une anecdote du musée du vagin ? L’un des meilleurs souvenirs que j’ai. Dans le musée, on a un mur de photos de vulves : toutes formes, couleurs, pilosités, etc. C’est super varié, on pourrait passer des heures à le regarder.
Un jour, une de nos hôtesses d’accueil m’a raconté que deux femmes sont sorties de cette exposition et discutaient juste devant elle. L’une d’elles a dit : "Tu sais, je crois que mon copain n’apprécie pas l’apparence de ma vulve." Et après avoir vu toutes ces images, elle a ajouté : "Mais en fait, elles sont toutes magnifiques, je suis magnifique, je suis unique. Et lui, il ne m’apprécie pas." Et là, elle a sorti son téléphone… et elle l’a quitté sur-le-champ. Et moi j’étais là : "Voilà. Ça, c’est changer des vies."
Question pour Sarah : Comment peut-on contribuer au développement du projet ISALA à l’échelle mondiale ?
Oh, bien sûr. Vous êtes les bienvenu·es pour nous rejoindre. Vous pouvez tout simplement suivre le projet : nous avons une newsletter qui sort à chaque saison, dans laquelle nous partageons les résultats, les actualités, tout ce qu’il se passe. Mais vous pouvez aussi participer activement. Regardez s’il existe un projet Isala dans votre pays. S’il n’y en a pas, vous pouvez nous contacter, et en lancer un avec nous.
Comment s’appelle déjà celui en France ? Madeleine. Oui, Madeleine. Donc il y en a aussi un en France. Donc, si vous êtes en France et que vous souhaitez participer, je peux vous mettre en relation. C’est en collaboration avec l’Institut Pasteur. Donc oui, nous avons aussi une “sœur” française dans ce projet !
Et je voulais aussi revenir sur le sujet précédent. Dans l’une des études qu’on mène en lien avec la sociologie, on a aussi remarqué que certains médecins ont honte d’aborder certains sujets, notamment les médecins hommes. Même lorsqu’il s’agit d’une femme portant le voile, ou d’une femme perçue comme plus “diverse”, certains médecins se disent : “Ah, on ne va peut-être pas parler de sexualité avec elle, peut-être qu’elle n’a pas de rapports.” Mais… tout le monde a une vie sexuelle. Par exemple, on a fait une étude auprès de patientes atteintes de cancer du sein : elles peuvent avoir une sécheresse vaginale très douloureuse, et même dans ce cas-là, le sujet n’est pas abordé. Les médecins discutent de tout le traitement… mais pas de la santé vaginale. Ils sont mal à l’aise, ils hésitent. “On ne va pas parler de sexe avec vous. Vous n'avez peut-être pas de rapports sexuels." Mais tout le monde a des rapports sexuels. Donc ce n’est pas qu’un problème chez nous. C’est un enjeu global, pour tous les médecins, d’être capables de parler de ces sujets avec leurs patientes, peu importe leur origine, leur apparence, leur religion. Tout le monde mérite d’être informé, tout simplement. Je voulais juste rappeler que même les médecins peuvent ressentir une forme de gêne, alors qu’on imagine souvent qu’ils sont à l’aise avec tous les sujets. Ce n’est pas toujours le cas..
Merci, merci beaucoup. Une dernière minute, car nous sommes très en retard… Alessandra, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Alessandra : Oui, j’avais une question pour Sarah, parce que j’ai trouvé ses données très intéressantes. Si j’ai bien compris, vous avez dit que Lactobacillus crispatus représentait 48 % ? Mais j’ai été surprise de voir que Jensenii et Gasseri n’étaient présents qu’à 3 et 4 %, alors que dans la littérature, ils sont bien plus représentés. Donc ma question est : est-ce que c’est une moyenne de vos données ? Ou est-ce spécifique à l’Europe ? Parce que c’est vraiment différent de ce qu’on trouve dans les ouvrages de référence.
Sarah : Oui. Je pense que cela dépend beaucoup des pays. Si vous regardez les données des États-Unis, c’est assez différent. Mais là-bas, ils ont aussi une manière de stratifier les données par race — ce qui est une construction sociale, et qui n’a pas vraiment de sens scientifique. Nous, ce que nous essayons de faire, c’est de nous concentrer plutôt sur les niveaux socio-économiques. Et c’est là-dessus que nous cherchons à progresser : intégrer dans notre étude des femmes de tous horizons sociaux, y compris celles qui vivent dans la précarité ou qui ont un accès limité aux soins préventifs. C’est un groupe qu’il faut vraiment prendre en compte différemment. Mais de manière générale, l’Europe de l’Ouest a tendance à présenter des données assez similaires — sauf si on entre dans les sous-groupes spécifiques, où là, on voit que le niveau socio-économique devient un facteur plus déterminant. Et si on élargit à d’autres régions du monde : par exemple, en Ouganda, les savons vaginaux sont un sujet très populaire. C’est recommandé partout, on en trouve plein de marques en supermarché. C’est aussi une question de culture marketing, en quelque sorte. Et d’ailleurs, nous allons bientôt lancer un projet en Italie également..
Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais remercier toutes nos intervenantes exceptionnelles : Sarah, Laurence, Alessandra… Merci infiniment

 Microbiote buccal : très déstabilisé par le tabac… mais résilient
Microbiote buccal : très déstabilisé par le tabac… mais résilient
 Caries : roulette russe ou mauvaise pioche de bactéries ?
Caries : roulette russe ou mauvaise pioche de bactéries ?